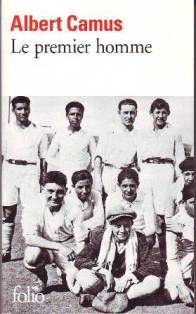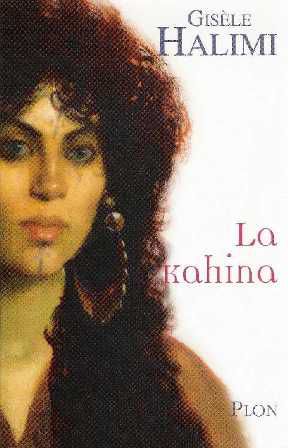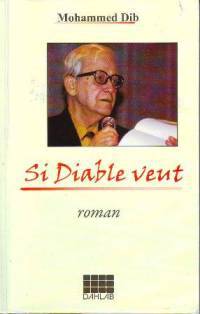Livres
Livres lus ou relus
Escales, nouvelles de Mouloud Mammeri. Les rendez-vous ratés des algériens avec la liberté
Escales, nouvelles de Mouloud Mammeri, 112 pages, éditions Bouchène (Alger) 1995.
En abordant ce recueil de nouvelles, notre intention est de traiter de l’une des parties les moins connues de l’œuvre monumentale de Mouloud Mammeri. Pourtant, la nouvelle, genre de fiction courte par définition devrait intéresser un lectorat plus large que le roman. Ce qui n’est pas le cas de M. Mammeri. A leur lecture, nous nous apercevons qu’elles ne correspondent pas tout à fait aux canons fixés par les maîtres du genre tel Guy de Maupassant. En effet, chez ce dernier, une nouvelle sert à raconter une histoire, décrire des personnages et des lieux et, enfin, surprendre le lecteur par une fin – souvent une chute- imprévue.
Chez M. Mammeri, la nouvelle – ou du moins les six nouvelles dont nous traitons - apparaît comme un prétexte pour faire part de réflexions - que je considère personnellement aussi profondes que justes - sur des moments cruciaux de l’histoire de l’Algérie. Les six nouvelles composant le recueil ont été écrites entre 1953 et 1987, c’est-à-dire sur une période de trente quatre ans. De ce point de vue, le titre d’« escales », qui est celui de la dernière nouvelle du recueil, peut être compris au sens de “pauses”, de “moments de réflexions” que M. Mammeri s’octroyait pour faire une sorte de bilan de la marche du temps.
La lecture de ces nouvelles permet de nous rendre compte avec quelle prévoyance et quelle constance l’auteur a fait, vis-à-vis de ses compatriotes et de ses lecteurs, un devoir, qu’il considérait, oserais-je supposer, essentiel, celui de témoigner et d’éclairer sur les séquences les plus dramatiques et décisives de l’histoire d’une Algérie engagée corps et âme dans une rupture sanglante avec l’ordre colonial pour se retrouver, une fois indépendante, prise en otage par la partie de ses enfants la plus avide de pouvoirs, de richesses et d’honneurs, autrement dit la moins apte à diriger et gérer les affaires du pays.
M. Mammeri fait le choix, non pas tellement de raconter des histoires, mais de mettre en situation des personnages pris dans des tourbillons de contradictions qui, souvent, les dépassent. Il fait parler ses personnages en même temps qu’il parle par leur intermédiaire. Des personnages, visiblement inspirés de la réalité, dans lesquels des lecteurs pourraient se reconnaître ou, à défaut, reconnaitre des personnes croisées dans la vie. Dans la dernière nouvelle, « escales », M. Mammeri va jusqu’à se mettre lui-même en scène face à l’intellectuel parisien adepte de la révolution mondiale et au chauffeur de taxi cairote amoureux de sa ville, lui, le ressortissant d’un pays libéré par le sang versé de ses enfants martyrs.
Ces nouvelles, toujours actuelles, nous arment de sagesse et de lucidité afin de nous éviter de croupir dans les “prisons” mentales érigées en forteresses par les ennemis de la libération de l’Algérie d’hier et les ennemis des libertés des algériens et algériennes d’aujourd’hui.
Présentation des nouvelles
Ameur des Arcades et l’ordre (1953)
Garçon de 10 ans, sans parents ni logis, Ameur vit au jour le jour de petits boulots, parfois inimaginables pour le commun des mortels. Attirée sans doute par sa vivacité d’esprit, une dame de charité à ses moments perdus, l’épouse de l’administrateur de la commune, tous deux des pieds-noirs, entreprend de le « civiliser » en lui apprenant l’alphabet et les bonnes manières. Après avoir réussi durant un certain temps à répondre brillamment aux désidératas de l’épouse de l’administrateur, Ameur choisit de garder sa liberté, quitte à retourner à l’état « sauvage » de garçon abandonné.
Le zèbre (1957)
Pur produit de l’école traditionnelle dite coranique, le zèbre, initié par un « alim » (érudit ou savant) à la culture profane, décide de participer aux mouvements du monde qui se déroulent dans l’aire maghrébine. Après plusieurs années de vains combats, il échoue au bercail – l’école coranique de sa jeunesse- telle une épave crachée par les vagues marines.
La meute (1976)
Enfin, l’Algérie est indépendante ! Durant des mois et des mois, les algériens fêtent la libération, ivre de bonheur au point de confondre la libération collective avec leur liberté individuelle. Un « prophète » ou « provocateur – c’est selon le point de vue où l’on se place – les avertit inlassablement, en usant de paraboles, des dangers à venir. La meute, c’est-à-dire mesdames et messieurs tout le monde, lui fera payer de sa vie d’avoir vu et dit la vérité.
Ténéré atavique (1981)
La dualité Sahara –Tell est inscrite dans l’histoire de l’Algérie. En période de disette, des populations du Sud saharien déferlent sur les terres cultivées du Nord méditerranéen. En période d’occupation de ces dernières par les puissances d’outre-méditerranée, le Sahara devient pour les paysanneries du Tell une zone de repli pour survivre et repartir à l’assaut des envahisseurs.
Avec l’indépendance, le Sahara est absorbé par le Tell au moyen de l’installation des infra et super structures de la vie moderne, plaçant les populations du Sud dans un lien de dépendance par rapport à l’Etat et à ses services collectifs, ce qui est contradictoire avec le mode de vie saharien, nomade, autarcique et, de ce fait, libre.
L’hibiscus (1985)
Au jardin d’Essai du Hamma (Alger), un gardien philosophe explique à un jeune (apprenti ?) révolutionnaire les ressemblances frappantes entre la condition des animaux sauvages mis en cage et exposés au zoo de l’endroit avec celle des hommes et femmes du pays, le notre, qui a raté les rendez-vous avec les libertés.
Escales (1987)
A l’occasion de ses séjours successifs à Paris et au Caire, un algérien bien dans sa peau – en l’occurrence l’auteur, M. Mammeri – est confronté, à travers deux personnages, à deux représentations divergentes des gens de sa nationalité :
- celle, apparemment positive, du militant parisien de la révolution mondiale, membre au temps de la guerre de libération nationale du réseau de soutien dit des porteurs de valises ;
- celle, apparemment négative, du chauffeur de taxi cairote amoureux de sa ville, de la vie comme elle vient et réfractaire aux luttes sanglantes même au nom des grandes causes.
Extraits choisis des nouvelles
Ameur des Arcades et l’ordre
Il faisait tout de même d’étonnants progrès, Ameur, ne mettait plus ses coudes sur la table, ne parlait pas la bouche pleine ; il ne disait plus « purée » à chaque instant. Il restait bien quelques taches encore : ainsi Ameur avait peu le sens de la hiérarchie, comme ses rapports avec Mme Pillot ne le montraient que trop.
Mme Pillot, avant d’être la femme de l’administrateur de la commune, était institutrice. Elle croyait au loup-garou, Mme Pillot : elle était par exemple convaincue qu’il était de son devoir de distribuer des collyres aux yeux rougis de trachome, des pommades aux peaux rongées de pustules. Elle ne soignait pas les estomacs, sonores d’être creux ; bien sûr, c’éatit impossible, mais aux grandes fêtes elle faisait distribuer de grands plats de couscous, aux frais de la commune bien entendu : elle appelait cela soulager la misère.
(Page 16)
Le zèbre
Le comble fut quand l’alem lui apprit que des poètes avaient chanté l’amour, les fleurs et le vin, la gloire et la guerre, dans la langue même du Prophète. Il avait toujours cru jusque-là qu’on ne pouvait se servir de la langue du Prophète que pour les vérités révélées ou les règles impératives du droit. D’abord, il se cacha pour lire ces livres profanes, convaincu qu’on se vouait au diable à chanter avec les mêmes mots, la même musique -parfois perfide, plus délicieuse encore -, Dieu et la bien-aimée ; mais l’alem finit par le convaincre.
(Pages 27-28)
La meute
Puis les souvenirs étaient allés s’estompant et il avait fallu de nouveau se remettre à la routine des jours. L’exaltation est comme l’incendie : elle se nourrit d’elle-même mais à la fin meurt épuisée. Puis de nouveau des bruits, d’abord sourds (comme avant), puis de plus en plus éclatants, coururent les marchés, les villes, les gourbis. Maintenant que l’ennemi n’était plus, les grands chefs s’étaient mis à continuer entre eux les grandes manœuvres, ils étaient « Tlemcen », « Tizi – Ouzou », « Zone autonome », « Fédération de France ». Le peuple ne comprenait plus. Le jeu était absurde. Comme il ne savait pas lire avec des mots, le peuple imagina de le dire avec son corps. Il se coucha par nappes sur les routes : les tanks de tous les points cardinaux ne pouvaient plus passer sur l’asphalte sans d’abord leur passer sur le corps. Le jeu cessa.
(Page 43)
Ténéré atavique
Ainsi ai-je découvert qu’ici était l’Afrique profonde. Ici apparaissait la vanité d’une histoire funambule, toute entière tournée vers la mer, fascinée par les rivages, les mirages d’une Méditerranée, pendant des siècles le centre du monde, par ses cités, ses iles, ses empires, ses temples, ses fables et ses incantations. Aux prestiges alternés, délétères, d’une mer qui n’était intérieure que pour les autres (ils disent « nostrum » en parlant d’elle, comme pour nous exclure), l’Afrique concédait une frange d’elle-même, la plus extérieure. Là s’accrochaient les comptoirs puniques, romains, grecs ou turcs, qui suçaient la substance du pays vrai : l’Afrique, grenier de Rome, après avoir pourvu de milliers de cavaliers les armées du chef borgne monté sur l’éléphant Gétule. Par-delà les limes était le pays vrai.
(Page 62)
L’hibiscus
Les yeux du gardien machinalement épiaient le geste vandale qu’il réprimerait sans joie. A quoi bon le lapsus de la colère ? Les choses sont comme elles sont, il est puéril de se blesser aux arêtes. Les arbres et les fleurs sont condamnés au même coin de terre ; quelquefois, comme ici, c’est une terre d’exil ; les bêtes, perverses ou pas, sont prisonnières de leurs barreaux et les hommes tournent dans les layons de leurs interdits. Tout le reste c’est de la dentelle.
(Page 93)
Escales
- Partez en paix, monseigneur, partez !…
Je luis tendais à bout de bras de vertes livres égyptiennes, il fuyait devant.
- C’est pour la course … C’est combien, la course ?
- C’est pour rien, effendi, pour rien !… Le plaisir de vous avoir connu n’a pas de prix…
Je dus courir derrière lui plus de cent mètres avant de fourrer l’argent dans la poche de son veston. Il pouvait comme tout un chacun aimer le bakchich, mais j’avais le choléra - et le choléra, c’est plus fort que la passion du bakchich.
En me regardant m’éloigner, il dit simplement:
- C’est comme cela que vous avez sorti les Français de votre pays…vous aimez la mort…
Je hurlais: - Non ! oustaz, non ! Jamais de la vie ! Nous aimons la vie … comme vous… comme tous les vivants de ce monde … Mais pas n’importe quelle vie, tu comprends ? Oustaz, pas n’importe laquelle !
Il me regarda longuement:
- Tu es algérien, mais tu es vivant … et c’est l’essentiel.
Derrière moi, longtemps j’entendis sa voix rauque égrener sur la poussière du trottoir, juste sur mes talons:
- Hayat !… Hayat ! … La vie!…
(Page 110)
Adrar yedren (la montagne vivante), recueil de poèmes d'Halima Aït Ali Toudert. La poésie comme oxygène

Adrar yedren (la montagne vivante), poèmes en tamazight de Halima Aït Ali Toudert, traduction française de Boukhalfa Bitam, 112 pages, année 1997, publication à compte d'auteur.
Avant de nous faire découvrir ou redécouvrir l'interprétation du monde des êtres humains selon les mythes et symboles amazighs contenus dans les contes de son recueil présenté dans ce blog en juin 2010, Halima Aït Ali Toudert nous a livré avec ses poèmes en tamazight, variante kabyle (accompagnés de la traduction française de Boukhalfa Bitam), une fresque sur beaucoup des aspects de la vie des imazighen montagnards de Kabylie. Cette fresque écrite dans un style plein de nuances, de retenue en même temps que de force a été conçue, jour après jour, à l'image du tapis traditionnel qui remplit petit à petit le métier de la tisseuse.
Ces poèmes sont largement inspirés des heurs et malheurs des algériens, en particulier des montagnards de Kabylie, magnifiés par le talent et la sensibilité de l'auteure, et traitent de bien des questions culturelles, sociales et politiques qui ont de tout temps mobilisé la réflexion et l'action des individus et des groupes considérés.
L'auteure réalise ses travaux de création en s'inscrivant dans une tradition multi-séculaire de poètes qui ont rempli les fonctions indissociables, d'une part, de témoins de la vie des hommes et des femmes de leur temps et, d'autre part, de porte-paroles de leur combat pour la liberté, la justice et le bien-être.
Les poèmes figurant dans le recueil sont au nombre de quarante cinq classés à l'intérieur des dix thèmes suivants : la Femme ; amour, amitié et séparation ; moments de joie ; nostalgie ; la guerre de libération ; corruption, arbitraire et médiocrité ; hommes et femmes d'antan ; poètes ; la mal-vie ; fierté, lutte et espérance.
Halima Aït Ali Toudert aime à réciter ses poèmes devant un auditoire choisi. Debout, droite, elle les dit avec gravité et conviction. Et aussi avec cette humilité, pour moi admirable, qui caractérise les poètes et créateurs d'oeuvres vraiment dignes d'intérêt.
Poème choisi de "Adrar yedren"
Version originale: ASENDUQ N TAḌAMUN
I waḍu nni id-d iṣuḍen
Asmi I nḍeggeṛ lfeṭṭa
Γuri taeṣebt uqerru
Ṭ-ṭebzimt i-d teǧǧa yemma
Γuri sin yebzimen
Akw d umeclux n nnila
Γuri tazra m lḥarz
Akw d uxelxal bu tsura
Sdukwleγ-ten d a kemmus
Cegɛaγ-ten I ben bella
Ixeddem-aγ-d icebcaqen
Mkul agram slaγla
Asenduq n taḍamun
Ibuy abrid n trewla
Ad zmaγ deg yiman-iw
Acimi I neshel I tḥila
Traduction française: LE TRESOR DU PEUPLE
Quel était ce vent de folie
Qui nous a fait jeter
Nos bijoux ?
J'avais un diadème
Et une broche venant de ma mère,
J'avais deux fibules
Et des bracelets à émaux,
J'avais collier à girofle
Et gaines de pied à fermoir
J'en ai fait un colis
Et tout donné à Ben Bella
Lui nous donna monnaie
De vil métal
Qu'on ne pouvait gagner
Qu'à grande peine.
Les coffres pleins d'or
Ont pris la fuite…
Amers reproches à moi-même
Pourquoi sommes-nous si faciles à duper ?
Le premier homme, roman inachevé et posthume d'Albert Camus. L'autre fils du pauvre.
Le premier homme, d'Albert Camus paru aux éditions Gallimard (Paris), collection Folio, 380 pages, année 2009.
Force des témoignages
A défaut d'être un roman, tel que l'a projeté son auteur disparu prématurément des suites d'un accident de voiture, « Le premier homme » apparaît d'abord comme un témoignage de grande importance sur les conditions de vie au 20ème siècle de la frange la plus pauvre de la population européenne habitant le quartier de Belcourt d'Alger. Et la famille d'Albert Camus a fait partie de ce monde de misère et de dignité (les deux allant très souvent ensemble) qu'il nous décrit méthodiquement par cercle concentrique, du plus proche au plus éloigné.
Le premier cercle, c'est sa mère et son père. L'utilisation de la troisième personne lui permet de raconter sa venue au monde le jour même de leur arrivée à Mondovi (actuel Dréan, près d'Annaba) après un long et épuisant voyage depuis Alger. Nous saurons en lisant la suite du texte, que sa venue en ce monde est totalement imaginée faute de témoignages, à commencer par ceux de sa mère vivante mais n'ayant jamais pu dire grand-chose sur cette période de sa vie ainsi que sur son mari. Mobilisé quelques mois plus tard pour les combats de la 1ère guerre mondiale, il – le père d'Albert Camus - est tué à l'âge de 29 ans par un éclat d'obus reçu à la bataille de la Marne. L'arrivée à Mondovi et la venue au monde nous apparait comme l'un des chapitres les plus vrais et plus beaux. Beauté et vérité qui viennent paradoxalement du caractère fictif des détails de ces événements. Détails dont la création a permis à l'imagination et au style de l'auteur de s'exprimer pleinement.
Les autres cercles suivent l'un après l'autre: la famille du petit Albert (sa mère, sa grand-mère, ses oncles et ses tantes), ses petits camarades de jeux dans les ruelles, les terrains vagues, les caves abandonnées, la plage (« Les sablettes ») située en face de Belcourt, quartier « mixte » d'Alger où vivent côte à côte (et pas du tout ensemble) les deux communautés, l'européenne et l'autochtone, et enfin l'école. Il s'attarde particulièrement sur ses relations avec quatre familiers : sa mère, aimante et silencieuse, sa grand-mère, chef de famille sévère et autoritaire, son oncle Ernest, un bel homme, simple d'esprit et plein de joie de vivre, son instituteur, guide et père spirituel.
La fin des études primaires marque pour le petit Albert celle d'une période de son existence où sa vie est limitée aux horizons restreints de sa famille et de son quartier. Au lieu d'aller travailler pour soutenir les siens comme l'a voulu au départ sa grand-mère, suivant en cela l'usage dans son milieu social, il arrive, en raison de ses excellents résultats scolaires et avec l'aide de son instituteur, à passer avec succès l'examen d'entrée au lycée. Une fois au lycée, il commence à se détacher tant physiquement, l'établissement, où il passe la journée entière en demi-pension, est situé en quartier résidentiel, que moralement, les voies de la connaissance lui sont désormais grandes ouvertes, de son milieu de pauvres obligés de consacrer leur temps et leurs moyens à la lutte pour la survie.
Les témoignages de l'auteur s'arrêtent là, c'est-à-dire à sa période de lycée. Cela a pu lui paraitre suffisant pour expliquer son parcours exceptionnel d'écrivain, prix Nobel de littérature, dans la mesure où il est convaincu que sa réussite « de fils du pauvre », de surcroît orphelin de guerre, il la doit aussi à l'école publique comme certains petits arabes de sa génération. Il est également vraisemblable que sa disparition prématurée l'ait empêché de continuer son œuvre non seulement en termes de travail d'écriture - le constat est évident à ce sujet - mais de période de temps couverte par ses témoignages. En tout cas, ces deux hypothèses ne nous paraissent pas exclusives l'une de l'autre.
Cohérence entre les idées et les actes
Outre les éclairages sur ses conditions de vie et celles de son entourage, l'autre intérêt des témoignages est la qualité du regard rétrospectif porté sur les gens et les événements. Qualité du regard qu'il nous semble intéressant de comparer, fusse-t-il de manière très sommaire, au contenu de ses œuvres littéraires et au sens de ses positions politiques, surtout celle en rapport avec le statut présent et futur de l'Algérie. Il identifie deux cassures majeures dans la société coloniale : d'une part, la cassure entre les autochtones et les européens et, d'autre part, celle entre les pauvres et les riches parmi ces derniers. Ces cassures, signes parmi d'autres de la cruauté du monde pour le plus grand nombre, ont largement imprégné l'œuvre d'Albert Camus en y installant ce climat permanent de vide dans les existences. C'est du moins ce vide existentiel, attribut d'un monde sans âme et sans cœur, que nous avons constamment ressenti à la lecture, il y a maintenant plus de quarante ans, de deux de ses romans, « l'étranger » et « la peste ». Ce climat de vide résonne comme un écho à l'histoire de ces européens pauvres, à l'image de ses parents, obligés de consacrer la totalité de leur temps et de leur énergie à se battre pour survivre au jour le jour sans rien pouvoir consacrer à la dimension intellectuelle de l'existence, telle par exemple la pratique de la religion, catholique en ce qui les concerne.
Quant aux positions politiques d'Albert Camus, elles nous paraissent comme les reflets de son histoire personnelle de français d'Algérie de condition modeste ayant pris la posture de l'homme révolté appuyée par son statut d'écrivain et homme de culture. Il est à la fois contre le système colonial et contre l'indépendance de l'Algérie. Il est pour la justice en faveur des pauvres et des sans- voix, arabes et européens. Nous considérons qu'Albert Camus a su mettre en cohérence ses écrits et ses positions politiques avec ses principes d'homme épris de justice. Seule réserve (mais en est-il vraiment responsable ?) : l'impact limité de ses positions politiques auprès des populations tant européennes qu'autochtones depuis longtemps travaillées par des courants définitivement antagoniques, patriotisme algérien, idéologie des opprimés, contre racisme colonial, idéologie des oppresseurs.
Extraits choisis de « Le premier homme »
L'ile immense
Au dessus de la carriole qui roulait sur une route caillouteuse, de gros et épais nuages filaient vers l'Est dans le crépuscule. Trois jours auparavant, ils s'étaient gonflés dans l'Atlantique, avaient attendu le vent d'Ouest, puis s'étaient ébranlés, lentement d'abord et de plus en plus vite, avaient survolé les eaux phosphorescentes de l'automne, droit vers le continent, s'étaient effilochés aux crêtes marocaines, reformés en troupeaux sur les Hauts plateaux d'Algérie, et maintenant, aux approches de la frontière tunisienne, essayaient de gagner la mer Tyrrhénienne pour s'y perdre. Après une course de milliers de kilomètres au-dessus de cette sorte d'île immense, défendue par la mer mouvante au nord et au sud par les flots figés des sables, passant sur ce pays sans nom à peine plus vite que ne l'avaient fait pendant des millénaires les empires et le peuples, leur élan s'exténuait et certains fondaient déjà en grosses et rares gouttes de pluies qui commençaient de résonner sur la capote de toile des quatre voyageurs.
(Extrait de la page 13)
Le père mort à la guerre
Il revoyait sa vie folle courageuse, lâche obstinée et toujours tendue vers ce but dont il ignorait tout, et en vérité elle s'était toute entière passée sans qu'il ait essayé d'imaginer ce que pouvait être un homme qui lui avait justement donné cette vie pour aller mourir aussitôt sur une terre inconnue de l'autre côté des mers. A vingt-neuf ans, lui-même n'était-il pas souffrant, fragile, tendu volontaire, sensuel, rêveur, cynique et courageux. Oui, il était tout cela et bien d'autres choses encore, il avait été vivant, un homme enfin, et pourtant il n'avait pensé à l'homme qui dormait là comme à un être vivant, mais comme à un inconnu qui était autrefois passé sur la terre où il était né, dont sa mère lui disait qu'il lui ressemblait et qui était mort au champ d'honneur.
(Extrait de la page 35)
La mère
Quand il arriva devant porte, sa mère l'ouvrait et se jetait dans ses bras. Et là, comme chaque fois qu'ils se retrouvaient, elle l'embrassait deux ou trois fois, le serrait contre elle de toute ses forces, et il sentait contre ses bras les côtes, les os durs et saillants des épaules un peu tremblantes , tandis qu'il respirait la douce odeur de sa peau qui lui rappelait cet endroit, sous la pomme d'Adam, entre les deux tendons jugulaires, qu' il n'osait plus embrasser chez elle, mais qu'il aimait respirer et caresser étant enfant et les rares fois où elle le prenait sur ses genoux et où il faisait semblant de s'endormir, le nez dans ce petit creux qui avait pour lui l'odeur, trop rare dans sa vie d'enfant, de la tendresse. Elle l'embrassait et puis, après l'avoir lâché, le regardait et le reprenait pour l'embrasser encore une fois, comme si, ayant mesuré en elle-même tout l'amour qu'elle pouvait lui porter ou lui exprimer, elle avait décidé qu'une mesure manquait encore. « Mon fils, disait-elle, tu étais loin »
(Extrait des pages 68-69)
Algériens envoyés à la boucherie
Tout se passait là-bas en effet où les troupes d'Afrique et parmi elles H. Cormery, transportées aussi vite que l'on pouvait , menées telles quelles dans une région mystérieuse dont on parlait, la Marne, et on n'avait pas eu le temps de leur trouver des casques, le soleil n'était pas assez fort pour tuer les couleurs comme en Algérie, si bien que des vagues d'Algériens arabes et français, vêtus de tons éclatants et pimpants, coiffés de chapeaux de paille, cibles rouges et bleues qu'on pouvait apercevoir à des centaines de mètres, montaient par paquets au feu, étaient détruits par paquets et commençaient d'engraisser un territoire étroit sur lequel pendant quatre ans des hommes du monde entier, tapis dans des tanières de boue, s'accrocheraient mètre par mètre sous un ciel hérissé d'obus éclairants d'obus miaulant pendant que tonitruaient les grands barrages qui annonçaient les vains assauts. Mais pour le moment il n'y avait pas de tanière, seulement les troupes d'Afrique qui fondaient sous le feu comme des poupées de cire multicolores, et chaque jour des centaines d'orphelins dans tous les coins d'Algérie, arabes et français, fils et filles sans père qui devraient ensuite apprendre sans leçon et sans héritage.
(Extrait des pages 82 et 83)
Le juste
Au coin de la rue Prévost-Paradol, un groupe d'hommes vociférait. « Cette sale race », disait un petit ouvrier en tricot de corps dans la direction d'un arabe collé dans une porte cochère près du café. Et il se dirigea vers lui. – Je n'ai rien fait », dit l'arabe. « Vous êtes tous de mèche, bande d'enculés », et il se jeta vers lui. »Les autres le retinrent. Jacques dit à l'arabe : »Venez avec moi », et il entra avec lui dans le café qui maintenant était tenu par Jean, son ami d'enfance, le fils du coiffeur. Jean était là, le même, mais ridé, petit et mince, le visage chafouin et attentif. « Il n'a rien fait, dit Jacques. Fais-le entrer chez toi ». Jean regarda l'arabe en essuyant son zinc. « Viens », dit-il, et ils disparurent dans le fond.
En ressortant, l'ouvrier regardait Jacques de travers. « Il n'a rien fait », dit Jacques. –Il faut tous les tuer. – C'est ce qu'on dit dans la colère. Réfléchis.
(Extrait des pages 87-88)
La vie, la mort et la religion
A vrai dire, la religion ne tenait aucune place dans la famille. Personne n'allait à la messe, personne n'invoquait ou n'enseignait les commandements divins, et personne non plus ne faisait allusion aux récompenses et aux châtiments de l'au-delà. Quand on disait de quelqu'un, devant la grand-mère, qu'il était mort : « Bon, disait-elle, il ne pétera plus »S'il s'agissait de quelqu'un pour qui elle était censée au moins avoir de l'affection : »Le pauvre, disait-elle, il était encore jeune », même si le défunt se trouvait être depuis longtemps dans l'âge de la mort. Ce n'était pas inconscience chez elle. Car elle avait vu beaucoup mourir autour d'elle. Ses deux enfants, son mari, son gendre et tous ses neveux à la guerre. Mais justement, la mort lui était aussi familière que le travail ou la pauvreté, elle n'y pensait pas mais la vivait en quelque sorte, et puis la nécessité du présent était trop forte pour elle plus encore que pour les algériens en général, privés per leurs préoccupations et par leur destin collectif de cette piété funéraire qui fleurit au sommet des civilisations.
((Extrait des pages 181-182)
Nouvelles d'Algérie. Expressions libres sur des réalités refoulées
Nouvelles d'Algérie, de Leila Marouane, Rachid Boudjedra, Hamid Skif, Amine Zaoui, Anouar Benmalek et Atmane Bedjou, éditions Magellan et Cie (Paris), APIC (Alger) et Courrier international (Paris), collection « Miniatures », 130 pages, année 2009.
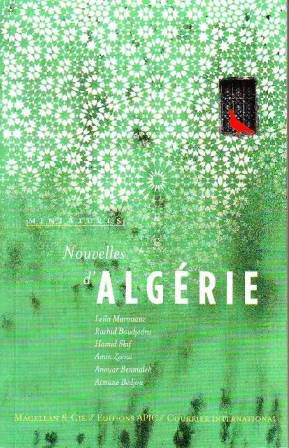
Les nouvelles signées d'auteurs algériens connus, sont au nombre de six. Nous en faisons d'abord les brefs résumés de présentation, puis livrons nos impressions d'ensemble à leur sujet.
Expression des interdits
Mon tuteur légal, de Leila Marouane
Le tuteur de l'héroïne de cette nouvelle, c'est son frère, « jumeau » précise-t-elle. Tôt devenus orphelins de père et de mère, ils sont happés dès leur entrée à l'université par les contradictions aigues que connait la société algérienne des années 1970-80. Partenaires et complices en beaucoup de choses, ils le sont aussi dans leur engagement militant dans un groupuscule clandestin d'extrême gauche. Mais, dès que les algériens se mettent en guerre les uns contre les autres, les deux personnages entrent également dans un combat fratricide à huis-clos. La cause : le frère qui veut marier sa sœur à un parti intéressant, de force s'il le faut…
Les violences et les tueries dans les villes, les maquis et sur les routes sont comme des complications monstrueuses des fractures qui traversent la société algérienne, à commencer par les familles, où les désordres et les conflits sont endémiques même en période calme pour ne pas dire de paix.
Chronique de l'année du barbelé, de Rachid Boudjedra
Prise dans les crocs d'un ordre cannibale, une vieille femme perd peu à peu ses liens à la vie avec la disparition mystérieuse l'un après l'autre de son mari et ses fils. Son village est sous le contrôle « d'arpenteurs diplômés », sorte de miliciens sans foi ni loi, dont la tâche consiste à placer continuellement des barbelés et, accessoirement, tirer à vue sur les gens rien que pour se débarrasser de leurs réserves de munitions.
Le lézard, de Hamid Skif
L'auteur décrit l'univers intérieur d'un algérien ordinaire atteint d'une haine qui semble incurables pour les autres, à commencer par sa femme, disparue un jour on ne sait comment, en qui il voit une prostituée aimant organiser des orgies jusque dans le domicile conjugal. Seule sa fille, jeune femme, trouve grâce à ses yeux même si son fiancé puis mari présente les signes apparents d'un souteneur.
Sa haine des hommes est si forte qu'il préfère la compagnie des lézards élevés en grand nombre dans son minuscule appartement où il s'est retrouvé seul. D'où son surnom de « zarzoumia » (lézard en parler algérien).
L'Honneur de la trahison, d'Amine Zaoui
Comment la trahison se transmet comme un patrimoine familial en gardant les apparences sauves malgré le déshonneur qui ronge les consciences en profondeur. Explication : une femme et son amant, le neveu de son mari moudjahid de la guerre de libération nationale, s'entendent pour assassiner et faire disparaître ce dernier afin de pouvoir se marier et vivre ensemble. Devenue adolescente, la fille du défunt se fait engrosser par le neveu, son beau-père. La mère cache la grossesse de sa fille et, à la naissance du bébé, en fait son propre enfant.
L'échangeur, d'Anouar Benmalek
Le narrateur, un journaliste, est envoyé dans un pays arabe, dirigé par une dictature comme il se doit, pour couvrir un congrès scientifique. Les participants, narrateur compris, s'perçoivent que l'événement est utilisé par la dictature comme tribune pour annoncer des mesures d'ouverture en direction des opposants.
Le narrateur apprend par une journaliste autochtone, opposante, un temps internée et torturée, les pratiques autoritaires sorties tout droit des délires mégalomaniaques du dictateur, la plus stupéfiante étant la réalisation d'un échangeur d'autoroute tracé aux initiales de ce dernier et à l'intérieur duquel il se perd un jour comme dans un labyrinthe.
Mort au bout du monde, d'Atmane Bedjou
Le narrateur, un algérien émigré au Canada avec sa femme, raconte le rapatriement de la dépouille d'une compatriote récemment décédée des suites d'une maladie, laissant derrière elle une fillette née d'une union hors mariage. Le narrateur et sa femme connaissent la défunte depuis leur arrivée. Elle les a aidés à faire leurs premiers pas dans le pays d'accueil. La défunte a quitté l'Algérie, ou plutôt s'en est enfuie, et n'y a plus remis les pieds de son vivant, empêchée par le sentiment de honte d'avoir eu un enfant illégitime.
Voyages dans nos profondeurs
Voilà un recueil de nouvelles conçu et agencé comme un circuit touristique à travers l'Algérie des profondeurs, celle des non-dits, des hypocrisies et des interdits.
Au plan formel, ces voyages se succèdent dans une suite logique :
- elle commence par la fuite imminente vers l'étranger d'une femme réfractrice à la tutelle masculine,
- et finit par le retour dans un cercueil d'une autre femme ayant émigré au Canada, en passant par :
- la vieille femme dépossédée de son époux et de ses fils par les mercenaires sans âme d'une dictature monstrueuse,
- l'homme fou dans un monde qui ne l'est pas moins, plein d'amour pour sa fille et chargé de haine pour sa femme, toutes les deux prostituées,
- les deux amants diaboliques et leurs forfaits restés impunis car prenant la précaution de donner l'illusion de respecter une morale prisonnière des apparences,
- le journaliste, parti couvrir un congrès scientifique dans un pays arabe, qui prend connaissance, par une journaliste autochtone, des pratiques de pire gouvernance du dictateur local.
Les personnages de ces nouvelles parlent, aiment, travaillent, mangent, dorment, rient peu ou presque pas ; ils sont comme égarés dans leurs obsessions, interdits, hypocrisies, comme ces millions de personnes de chair et d'os qui s'y débattent leur vie durant pour la plupart, nous semble-t-il. Oui, toute la vie sauf pour une petite minorité d' « élus » de toutes conditions sociales qui mobilisent assez de force intérieure pour se libérer de leur prison mentale. Nos six écrivains nouvellistes en font justement partie et, plus encore, osent aller chasser nos démons collectifs dans des endroits inconnus cachés en chacun de nous. Sans leur travail d'éclaireurs, les ténèbres auraient occupé bien plus de place dans des esprits pourtant avides de lumière.
Extraits choisis
Mon tuteur légal
Elle écrasa la cigarette dans le cendrier, posa le livre sur la table de chevet, se leva. Elle attrapa l'enveloppe sur laquelle elle reconnut le cachet du tribunal. Elle en sortit la lettre, qu'elle parcourut rapidement.
Elle dit. Tu as fait ça ?
Il dit. La loi, c'est la loi. Je suis ton frère et unique tuteur. Ton tuteur à vie. Tu ne voulais pas l'entendre, maintenant tu peux le lire. Et ne t'avises pas de quitter le pays. J'ai alerté la police des frontières.
(Extrait de la page 11)
Chronique de l'année du barbelé
Depuis cette fameuse année du barbelé, l'intrusion des arpenteurs, l'incendie qui ravagea les deux cars du plus gros notable de la région, l'assassinat de l'imam en pleine mosquée et, de surcroît, un vendredi et au sujet duquel plusieurs versions avaient circulé, puisque les autorités officielles parlaient d'une syncope mortelle alors que les devins défendaient la thèse de la lévitation et juraient tout ce qu'ils pouvaient pour affirmer qu'ils avaient vu le défunt disparaître à l'horizon dans la cour découverte de la mosquée durant un vent de sable qui ne dura que quelques minutes, et que les farfelus, éternels barbus retranchés derrière leur tasse de café refroidi et leurs médisances au café de la Jeunesse, affirmaient, quant à eux, qu'il s'agissait d'une action terroriste…
(Extrait de la page 33)
Le lézard
Sous prétexte que mes poches étaient des sacs à immondices, elle ne trouvait jamais ce qu'elle y cherchait. Une seule fois, je vis un éclat victorieux dans ses yeux. Elle me mit sous le nez le lézard desséché découvert dans une des poches de ma veste. C'était un lézard vert, pas plus grand ça, mort de faim ou de vieillesse, trouvé derrière une rangée de dicos. Par pitié, j'avais décidé de lui offrir une sépulture décente. J'ai du respect pour les lézards. Je les préfère aux chats. Ils vivent très longtemps. Il leur arrive même de se sacrifier, offrant leur vie à ceux qui en ont besoin. Les chauves héritent des lézards. C'est grâce à eux qu'ils peuvent continuer à vivre après avoir perdu leurs cheveux. Très peu de gens le savent.
(Extrait de la page 46)
L'Honneur de la trahison
Et cet homme qui vit avec nous, Youssef, je l'appelle mon père. En réalité, il est le mari de ma mère, c'est-à-dire mon beau-père. Il est plus jeune que ma mère de quinze ans. Il s'est marié avec elle quarante-cinq jours après la mort tragique de mon père. Mon père était le plus célèbre puisatier de la région. Il est mort noyé dans un puits. On a découvert son corps totalement décomposé vingt-cinq jours après sa mort.
(Extrait de la page 82)
L'échangeur
Tu n'es pas un peu boursouflé dans ta dignité ? Et ne me fais pas le coup de celui qui a assez d'humour pour le supporter. Dans mon pays, tout le monde parle avec les yeux et avec les mains. Car celui qui parle avec la bouche risque de mourir. Toi, c'est autre chose, tu pourrais parler, mais mon pays regorge de trop de pétrole pour que ton pays veuille se fâcher avec le mien !
(Extrait de la page 97)
Mort au bout du monde
Et l'autre nation ? Est-elle toujours mienne après toutes ces années ? Mon pays que je ne revois qu'à petites doses, deux semaines, au maximum trois, par an ou tous les deux ans ? Et comment expliquer la force du lien à cette terre et à ces collines que je parcourais tout enfant ? Dans mes moments de désarroi, les roches sur lesquelles je me reposais en revenant de l'école prennent à mes yeux la valeur d'un être humain, de chair et d'os. Cette nation qui fait fuir ses enfants. Ces enfants mal-aimés qui ne se découragent jamais de revenir. Plus ils s'éloignent d'elle, plus ils s'acharnent dans cet attachement aux regs et à la glèbe de leur terre natale. Ils s'accrochent à son sol même après leur mort !
(Extrait de la page 121)
La Kahina (Dihya), roman de Gisèle Halimi. La femme unique en son genre.
La Kahina, roman de Gisèle Halimi, éditions Barzakh, Alger, année 2007, 260 pages.
Le roman historique consacré à la Kahina, ou de son vrai nom, Dihya - cette légendaire reine amazigh (berbère) des Aurès (Est de l'Algérie) - aurait eu valablement le statut de biographie si l'auteure, Gisèle Halimi, célèbre avocate et militante des droits des femmes, française et juive originaire de Tunisie, avait rassemblé assez d'informations sur sa vie. Mais ça n'est pas le cas même si la recherche documentaire réalisée par G. Halimi parait considérable au vu de l'imposante bibliographie - pas moins de 110 références - annexée à l'ouvrage. Toutefois, en raison sans doute du manque ou de l'absence d'informations sur bien des aspects de la vie de la Kahina, le résultat du labeur de G. Halimi ne pouvait être une biographie, c'est-à-dire une œuvre d'historien, statut qu'elle ne revendique pas au demeurant. En effet, l'auteure ne se prive pas d'y exprimer sa subjectivité en mettant en scène à travers l'archétype même de la femme résistante les principes de justice et de liberté qui ont guidé et jalonné ses propres combats pour les droits des peuples colonisés et des femmes.
Plus qu'un modèle bien inaccessible pour le commun des femmes, le personnage mythique de la Kahina est d'abord présenté par G. Halimi comme un héritage porteur de valeurs culturelles au moyen duquel son père a visiblement voulu, depuis son enfance, lui inculquer une ligne de conduite chargée d'exigences à suivre impérativement dans la vie.
Pour ceux qui, comme moi, ont cru en savoir assez sur la Kahina, la surprise est au rendez-vous. En effet, d'un côté G. Halimi expose en les confirmant tous les clichés plus ou moins négatifs qui ont depuis toujours circulé sur notre héroïne: magicienne, devineresse, prophétesse de confession judaïque, à l'instar des membres de sa tribu et de bien d'autres tribus berbères d'Afrique du Nord. G. Halimi nous dit que la Kahina est bien tout cela à la fois et que ce n'est guère incompatible avec les croyances de l'époque dont il reste quelques expressions dans les pratiques culturelles à caractère magico-religieux des pays maghrébins.
Mais l'auteure ne s'arrête pas là. Elle nous montre que si la Kahina s'est imposée à la tête de la résistance amazigh, c'est aussi grâce à des qualités "masculines", guerrières et autres, cultivées depuis son enfance contre la volonté de son père et de sa mère, dont elle était l'enfant unique, et de tout son entourage. A force de se battre au quotidien contre des normes socioculturelles qui attribuent des rôles strictement séparés aux deux sexes, elle réussit finalement dans son entreprise en arrivant à devenir une femmes doublée d'un homme. D'abord en se mariant et prenant des amants comme le ferait exactement un homme placé dans un position sociale dominante. Ensuite, aidée par ses dons de divination qui font d'elles aux yeux des amazighs une personne élue de Jahvé et des forces surnaturelles, en réussissant à dépasser la condition servile a laquelle sont d'ordinaire prédestinées les femmes pour devenir un chef politique, militaire et religieux.
C'est seulement à la fin de l'histoire, avec sa mort choisie dans un combat singulier contre le commmandant en chef de l'armée musulmane, qu'il nous est possible de mesurer toute la signification donnée par l'auteure à la vie de la Kahina: ayant réalisé bien des exploits à la portée des seuls êtres d'exception ( femmes et hommes à la fois), elle demeure un personnage unique dans l'histoire universel, un idéal en grande partie inaccessible aux femmes de tous les temps, y compris du 21ème siècle.
Nous nous apercevons également, combien G. Halimi, en rendant ce bel hommage à la Kahina, est elle-même amazigh et fière de l'être.
Extraits choisis de « La Kahina »
Le jour où Dihya devient une femme
(…) Yazdigan, Dihya l'eut de premières amours. Un pâtre grec avec lequel elle partagea ses joutes initiales. Ils avaient dix huit ans tous les deux, et Dihya voulut devenir femme. Elle n'oublia jamais ces rencontres, les bocages de genêt blanc, à l'ombre des jujubiers, qui lui apprirent la volupté. Encceinte, elle ne changea en rien sa vie de jeune cavalier combattant. Tout comme son amant. Elle accoucha seule dans la forêt. Et son fils, caché par sa nourrice, grandit dans la tribu, anonymement.
C'est seulement quand elle accompagna son père, Thabet, à la bataille de Tahouda qu'elle lui révéla l'existence de Yazdigan. Lui et Tanirt, sa mère, furent surpris. Mais ils réagirent en parents d'un seul enfant, une fille, certes, mais leur héritière et leur tendre préoccupation. « Fais-le venir parmi nous le plus vite possible, dit Thabet, il faut qu'il prenne son rang dans la tribu. » Il lui sembla alors qu'elle venait de conquérir sa liberté de femme, en même temps que son rang de guerrière. Et que cela valait bien une liberté d'homme.
(Extrait de la page 31)
Les victoires berbères
« il [ Koçeila] n'avait pas oublié la fulgurante apparition de Dihya sur le champ de bataille de Tahouda. Il connaissait les pouvoirs de cette femme sur les Djeraoua de l'Aurès, dont elle était issue, mais aussi sur d'autres tribus, qui pratiquaient comme elle, le judaïsme. Cette foi et cette religion, lui avait-on dit, seraient venues jusqu'en Afrique par des migrations des populations juives de Syrie, alors puissantes, et après la destruction du temple de Jérusalem. Les Nefouça, berbères de l'Ifrikiya, les Fendalaoua, les Mediouna, les Behloula, les Ghiata et les Fazaz du Maghreb –el-Acsa, autant de tribus également juives.
Les monts d'Aurès dessinaient le royaume de Dihya. La mobilité, le flux et le reflux de ses nomades, sa tactique. On la disait d'une grande intelligence mais aussi utilisant la ruse pour asseoir son pouvoir. Habile, volontaire, la Kahina savait limiter les pillages et le désordre quand elle passait dans une ville.
Depuis la mort d'Ockba, les tribus juives- pour le moment juives, se disait Dihya, sceptique, elle n'avait guère d'illusions sur leur versatilité et leur aptitude à passer dans le camp ennemi - faisaient acte de soumission. Son pouvoir surnaturel, deviner l'avenir et agir en conséquence, leur paraissait le plus sûr gage pour vaincre et organiser leur société nomade.
De son côte, Koçeila, lucide, avait drainé vers lui depuis la victoire de Tahouda, les grandes confédérations berbères, celles qui se réclamaient du christianisme avec celles qui sacrifiaient au culte des idoles . Leur enthousiasme et leur soutien militaire lui avaient permis de marcher su Kairouan, symbole et trophée de l'invasion arabe.
« Koçeila compris aussitôt que l'alliance entre lui et la reine berbère pouvait stabiliser ce peuple divisé, irrationnel. Pas question de le dompter, de le mettre sous le joug ou de lui imposer un ordre disciplinaire, fût-il celui d'un chef qu'ils s'étaient donné. Cette inconstance, d'ailleurs, lui donnait le pouvoir de disparaître et de réapparaître là où l'ennemi ne l'attendait pas. Il croit ces tribus mortes, défaites à jamais, elles renaissent dans un harcèlement perpétuel. Et obligent l'envahisseur à ne jamais se savoir en paix, ni à s'établir, ni à créer son ordre nouveau. »
(Extrait des pages 100-101)
Le commencement de la fin pour la Kahina
La Kahina alla au devant de Hassan, et livra bataille sur bataille. Elle jeta ses guerriers contre les dizaines de milliers de guerriers arabes. Autour d'elle, ses amis tombaient. Fière et droite, le javelot à la main, elle ferraillait. Elle sentait le poids de son isolement, et la fin de la splendeur berbère. Mais son peuple, une partie de l'histoire qu'elle a voulu écrire ne basculeraient pas dans le néant.
Constantinople ne l'aiderait plus, Tibère III, confronté aux revendications d'autonomie de certaines villes italiennes, ne pouvait, dans le même temps, barrer la route au jihad. L'Empire devait compter avec la conquête arabe. Une sorte de sage prédiction changeait une imagerie connue. On n'inclurait plus à l'avenir l'Afrique et ses greniers à blé, ses bocages et ses oliviers, dans cet Empire romain qui ébranla le monde.
(Extrait de la page 180)
Les dernières volontés de la Kahina
Elle [La Kahina] doit donc parler à ses fils aujourd'hui même. Leur sort doit être séparé du sien. « Va me chercher Ifran et Yardigan », ordonne-t-elle à Anaruz, son aide de camp.
Ses fils doivent vivre, elle le veut.
« Ce n'est pas seulement votre mère qui vous parle », avertit-elle en s'accroupissant sur la natte, le dos calé sur poutre de chêne. Ses fils sont là, devant elle, maigres et inquiets. Le regard oblique d'Ifran trahit sa peur. Que va-t-elle encore décider sa folle de mère ? Yazdigan, lui, ne la quitte pas des yeux, et murmure qu'il la trouve fatiguée. « Vieille, finie pour tout dire. Mais vous êtes mes fils et vous devez continuer notre race. De ces montagnes où ils sont nés, nos ancêtres nous ont enseigné l'honneur et la fierté ». La Kahina décroise ses jambes, pousse un petit râle, ses genoux la font souffrir. « Je vous demande de me faire un serment. » Ses fils, debout, n'ont pas bougé, figés dans l'attente et la crainte. « Ce serment, c'est de continuer notre race. » Elle relève la tête. « Vous allez vous rendre au général Hassan, vous convertir à l'islam pour avoir la vie sauve et lui rappeler comment la Kahina a traité ses prisonniers après la victoire de l'oued Nini. » Malgré l'écrasement de l'ennemi, elle avait donné une leçon d'humanité aux arabes qui prétendaient apporter au monde le vrai dieu. Et qui tuaient, pillaient, dévastaient. Elle avait renvoyé les prisonniers dans leur camp, adopté l'un d'entre eux – Khaled - , ordonné que tous fussent bien traités. « Vous vous mettrez au service de Hassan tous les deux ! » Yazdigan crie : « Non, pas sans vous, mère, non ! – Tu te mettras à son service », reprend-elle, impérieuse. Impassible, Ifran attend d'être congédié pour prendre son cheval et, au galop, rallier les premières lignes ennemies. « Comme toi Ifran. Ce n'est pas lâcheté que de se rendre quand la bataille se termine. Et que vous êtes vaincus. La vraie lâcheté, c'est celle des tribus qui ont trahi, de ces Imazighen qui ont abandonné notre lutte et notre Dieu. – Et vous, mère, vous ? Je ne vous abandonnerai jamais … Je mourrai avec vous… - Trêve de discussion, Yazdigan ! Hassan ne peut oublier que vous êtes fils de reine. Il vous confiera le commandement de nos frères. Dans l'honneur, aussi bien que dans l'adversité, vous continuerez la race. »
La Kahina répète : « Il faut que la race vive…Oui, l'honneur, c'est de faire vivre à jamais la race berbère. – Mère, reprend comme dans une plainte Yazdigan, mère je veux mourir avec toi… » Il l'a tutoyée, comme quand il était enfant. « Tu vivras. Et Ifran vivra. Je l'ai décidé. C'est le dernier commandement que je vous donne. » Elle n'effacera pas le passé, mais elle précipitera le présent dans un avenir sans elle.
Acu iγ –d-nnan ger yetran, recueil de contes kabyles de Halima Aït Ali Toudert. Le pouvoir magique des contes.
Acu iγ –d-nnan ger yetran, recueil de contes kabyles de Halima Aït Ali Toudert, Haut commisariat à l'amazighité (Alger), 70 pages, année 2004.
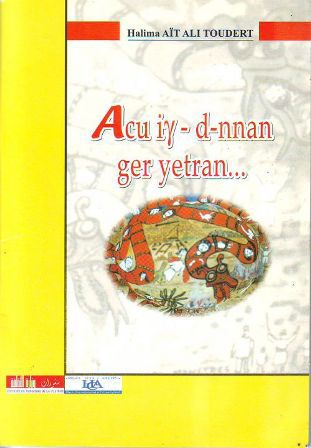
Introduit par l'entremise d'une parente commune, notre groupe de cinq personnes a été reçu au village de Tala N'Tazert (Tizi-Ouzou, Algérie) par Halima Aït Ali Toudert un vendredi d'avril 2010. Il a fait froid et plu abondamment, ce jour là.
En habits traditionnels, elle nous a fait un accueil aussi sobre que chaleureux et, dans sa maison centenaire, nous a montré sa collection d'objets anciens, surtout des ustensiles en bois ou en terre cuite, ainsi que des photos- souvenirs de sa participation à des manifestations dédiées à la culture amazigh.
Halima Aït Ali Toudert est une femme de culture au sens à la fois plein et traditionnel comme il en a existé en Algérie depuis les temps immémoriaux quoique de moins en moins à présent. Elle appartient à une lignée de femmes qui se sont consacrées à la transmission et l'enrichissement de la culture amazigh. Elle est aussi une poétesse reconnue ; je compte à ce sujet présenter dans ce blog un jour prochain une de ses œuvres que beaucoup trouvent magnifiquement réussie.
Les contes composant son recueil lui ont été transmis par sa défunte mère. ils sont écrits en Tamazight de graphie latine et ont été très brièvement résumés ci-dessous.
Résumés des contes du recueil
Allah Ulaεǧeb (Nom de Dieu !)
Son père et son frère absents pour un pèlerinage, une jeune fille voit sa vie tourner au drame à cause de sa grande beauté et arrive à retrouver le chemin du bonheur grâce à son intelligence et sa bonne étoile.
Asseḥḥar lǧihennema (Le magicien de l'enfer)
Un innocent petit garçon, orphelin de père, arrive à vaincre les forces de l'enfer, personnifiées par un méchant magicien, et s'empare d'un pouvoir magique qui lui permet d'échapper à la misère.
Silu (Silou)
Un père et une mère bornés apportent le malheur à leurs trois filles mariées et finissent par être les artisans de leur propre perte.
Tamacahutt n Uhusay Uḥṛic (Le conte du rusé garçon)
Un rusé garçon arrive, étape par étape en bernant des adultes, à posséder, à partir d'une simple épine, une fillette dont il est tombé amoureux.
ḥmed bu tkerciwt (Ahmed les tripes)
Un jeune prince, suite à un rêve prémonitoire, doit vivre sept années d'épreuves et réalise tant d'exploits qu'il arrive à mériter son statut royal hérité.
Mesmamda (Mesmamda)
Un rusé petit garçon, Mesmamda, défend son frère aîné assez niais contre la méchanceté de leurs parents puis le venge de la cruauté d'un vieil homme et d'une vieille femme qui les ont impitoyablement exploités l'un après l'autre.
Tamaccahutt n bu sebεa tullas (Le conte des sept filles et de leur père)
Leur père parti en pèlerinage, la cadette de sept filles sauve ses sœurs de l'attaque d'un ogre (mi-homme, mi-monstre), déjoue ses tentatives de vengeance et le fait tuer et dévorer par deux lions qu'elle a elle-même élevés.
Tamaccahutt n kṛaḍ n watmaten (Le conte des trois frères)
Un père laisse comme héritage à ses trois fils - nés chacun d'une mère différente, une française, une arabe et une kabyle- des pièces de monnaie, de la terre et des semences. N'arrivant pas à s'entendre sur la répartition de l'héritage, ils décident d'aller voir le vieux sage de la forêt pour les concilier. Ce dernier leur dit en substance : votre père a assigné à chacun de vous une tâche distincte, labourer ou semer et planter ou vendre et acheter. Il vous demande de ce fait de travailler, partager et vivre ensemble, fraternellement.
Taǧǧelt (La veuve)
Une veuve et son fils se trouvent abandonnés de tous et ne doivent leur salut qu'à la forêt qui leur offre un anneau magique pour vivre dans la richesse et à leur chien et chat pour aller le reprendre au méchant magicien qui l'a subtilisé.
Taqsiṭ tamsirt (L'histoire d'une leçon)
Un prince épris de justice s'oppose à son père, un roi oppresseur auquel il parvient à donner une ultime leçon qui lui coûtera sa couronne et permettre à son fils de lui succéder.
Tamaccahutt n jeḥḥa (Le conte de Djeha)
Le rusé Djeha roule trois fois de suite et à tour de rôle neuf frères. En bon connaisseur des faiblesses humaines, il parie avec succès sur leur cupidité – malgré leur richesse, ils en veulent toujours plus- et leur rivalité – aucun d'eux n'avertit les autres de sa mésaventure avec Djeha, au contraire.
Pourquoi les contes existent-ils?
En lisant ces contes dans leur version originale en Tamazight, variante kabyle, on se rend compte quels formidables outils pédagogiques ils ont été dans l'apprentissage des valeurs humaines par les enfants. Ajoutons cependant que lire un conte, c'est le trahir un peu car le conteur de jadis s'impliquait tellement dans ce qu'il disait qu'il devenait aux yeux des enfants quelqu'un qui transmet les histoires vraies du passé merveilleux et lointain où les animaux et les hommes se parlaient. Le but pédagogique des contes est à la fois de transmettre les valeurs fondatrices de la vie en société et de convaincre de leur nécessité quant à la pérennité de l'espèce humaine et de ses réalisations ou civilisations. En effet, dans les contes, la victoire finale revient toujours aux personnages portant et défendant les valeurs positives – amour dans ses différents visages, fraternité, solidarité, justice, intelligence, ingéniosité, ruse, etc. Et lorsque des valeurs négatives – jalousie, cupidité, injustice, mensonge, paresse, bêtise, etc. – triomphent, c'est jamais définitivement car les personnages qui les incarnent finissent tôt ou tard par être sévèrement châtiés soit par leurs adversaires directs soit par une force supérieure, humaine ou surnaturelle. Les personnages positifs changent en bien leur statut social toujours après un parcours initiatique semé d'épreuves destinées à sanctionner des progrès dans l'élévation de leur personnalité. Ces progrès ne se réalisent que par la mise en pratique réussie des valeurs humaines positives.
Ainsi du degré de mise en pratique de ces valeurs positives, en fait universelles, dépend le degré de réussite sociale et matérielle. C'est bien là le miracle éternellement renouvelé en œuvre dans les contes. Un miracle qui contribue sans doute à nous faire aimer la vie.
La fête des Kabytchous, récit de Nadia Mohia. Quelques vérités sur Muhend-u-yahyia, sa famille, les kabyles et les algériens


La fête des Kabytchous, récit de Nadia Mohia, 220 pages, éditions Achab, Tizi Ouzou (Algérie), année 2009.
« La fête des kabytchous » dont il s'agit dans le récit de Nadia Mohia, c'est l'enterrement au pays natal d'Abdellah Mohia, son frère aîné, Dadda en Kabyle, traduit par Grand frère en français- mort à l'hôpital après une longue maladie au bout de vingt huit ans d'exil en France précédées de vingt six autres années vécues en Algérie.
Abdellah Mohia, plus connu sous le pseudonyme de Muhend-u-Yehya, est un écrivain amazighophone, un intellectuel et créateur majeur pas suffisamment connu du public, d'autant plus qu'il s'est toujours volontairement effacé derrière ses oeuvres, considérant que sa mission au service de la culture kabyle et amazigh passe avant toute considération personnelle.
Son mode de vie solitaire frisant la misanthropie et sa personnalité complexe, vu son trop plein de qualités comme l'écrit l'auteure, demeureraient pour nous inconnus sans ce récit tissé patiemment et adroitement comme l'on ferait d'un grand et beau tapis traditionnel, objet à la fois utilitaire et artistique s'il en est. Pour cela, Nadia Mohia a bénéficié de deux atouts maîtres :
- une connaissance intime par beaucoup d'aspects de ce qu'a été la vie de Muhend-u- Yehya, en particulier le premier quart de siècle passé au pays.
- une maîtrise des instruments conceptuels d'observation, acquis au cours de ses études et recherches de terrain, lui permettant de nous révéler, sous l'angle de l'ethnologie et la psychanalyse, la personnalité hors norme de Muhend-u-Yehya.
Le récit de Nadia Mohia commence par son retour au pays, longtemps à la fois redouté et rêvé par son frère d'abord et elle- même également. Son retour est cette fois imposé par le rapatriement de la dépouille de Muhend-u-Yehya pour être enterré au village natal d'Ath Arvah, commune de Thassafth Ouguemoun.
Le récit a pour point d'appui les six mois d'hospitalisation de Muhend-u-Yehya durant lesquels le frère et la soeur se sont rapprochés comme jamais auparavant dans leur vie.
L'approche utilisée par l'auteure pour nous faire découvrir la face cachée de la personnalité de son frère consiste à nous restituer et analyser ses rapports avec sa mère (surtout elle), son père, d'une part, ses trois frères et sa soeur dont il est l'aîné, d'autre part. Il faut dire que la personne passionnée et tourmentée qu'a été la mère est, juste après Muhend ou- Yehya, la plus présente dans le récit. Viens en troisième position la soeur unique, l'auteure pour qui l'écriture sur son frère apparaît comme l'occasion de faire le bilan de sa propre vie.
Je reprends ci-dessous quelques uns des extraits du livre que j'ai trouvé particulièrement éclairants sur la personnalité et les idées de Muhend-u- Yehya.
Les livres
« Grand-frère et les livres. A une époque, il en avait plusieurs milliers dans sa cave. Après les avoir lus, il les vendit aux bouquinistes. IL aura vécu une grande partie de son existence dans les livres, les seuls objets auxquels il s'attachait, qu'il révérait même, allant jusqu'à les ramasser dans les poubelles :
- Ce n'est pas leur place », disait-il.
Ou dans les marchés aux puces de Saint-Ouen, en « marée basse », après que les marchands ont emballé leurs marchandises, laissant par terre les livres qui leur ont semblé sans valeur, c'est-à-dire invendables. Il les prenait non pour lui-même, mais pour les envoyer au pays.
-« S'ils en sont à s'entr'égorger là-bas, c'est qu'ils ne lisent pas de livres" pensait-il.
(Extrait de la page 55)
La survie :
Mon frère lui aussi cherchait un chemin dans sa vie fermée de toutes parts. Il ne vivait pas, il survivait. Les dernières années, il était véritablement acculé. Il fallait bien l'entendre répéter, bien avant le naufrage :
« Pas d'issue. Rien. C'est désespérant »
Certains jours, j'avais l'impression qu'il lisait dans mes pensées, lorsque me tenant auprès de lui, je songeais à ces phrases de Fritz Zorn dans Mars :
« Ce n'est pas ce que j'ai vécu de pénible qui me chagrine mais que cela continue encore à agir, encore et toujours, encore et toujours, encore et toujours. Ce n'est pas le poids du passé qui pèse mais qu'aucune fin, non plus, ne se laisse entrevoir, c'est cela qu'il est impossible de surmonter. »
(Extrait de la page 67)
La France :
Mon frère pensait que s'il avait quelque chose à dire qui méritait d'être entendu, ce n'est pas à ceux d'ici qu'il devait s'adresser, mais à ceux de là-bas. (Et voilà, sans doute, une des raisons qui l'ont amené à privilégier la langue maternelle dans son expérience littéraire.) Puisque, à eux seuls, ceux d'ici semblent déjà pouvoir tout penser, tout dire, tout écrire. Parce qu'ils sont riches et puissants, ils tendent à s'estimer également autosuffisants en matière de raison, de sensibilité, de philosophie. Aussi pourquoi rechercheraient-ils les minces lueurs des autres, eux qui n'ont de cesse que leur propre lumière, tel un soleil perpétuel au centre du ciel, ne rayonne dans tout l'univers. »
(Extrait de la page 90)
Les Kabyles :
Muhend - u- Yehya, lui, en était arrivé à cette conclusion lapidaire :
« Ur netturebb'ara ! » (« Nous n'avons pas été éduqués ! »)
Comprenez : « Nous les Kabyles, nous n'avons pas été construits, étayés, édifiés, orientés dans le bon sens »
D'aucuns, à la fierté chatouilleuse, trouveraient cette remarque exagérée, voire erronée. En tout cas, elle correspond bien au ton quelque peu emporte-pièce de Muhend-u-Yehya. Elle témoigne aussi de sa volonté de battre en brèche l'image magnifiée que les Kabyles ont tendance à arborer de leur culture, pas uniquement aux yeux des étrangers (Ah ceux-là, que seraient les Kabyles s'ils n'existaient pas ?), mais aussi, à leurs propres yeux. Ainsi se mentent-ils sur ce qu'ils sont. Ainsi se méprennent-ils sur leurs problèmes. Et comment s'étonner, alors, de leurs difficultés à les résoudre ?
(Extrait des pages 128 et 129)
Les « qualités abusives » :
A sa manière, il était pourtant une espèce de « monstre », tant il se montrait insaisissable, impénétrable, inflexible et irascible ; tellement il avait tendance à dépasser la mesure en toutes choses. Il était dans l'excès par son intelligence, par sa lucidité, par sa sensibilité, par sa droiture, par sa modestie, par son rejet des faux-semblants, par sa gouaillerie, par son indépendance, par sa vérité toute entière. Je pourrai le dire moi aussi, comme Guy de Maupassant dans un de ses romans : si mon frère péchait, c'était par ses « qualités abusives ». Il était habité, poussé par quelque chose sur lequel il n'avait aucune prise, qui l'entraînait dans une vie cahotante, tout en l'enchaînant en lui-même.
(Extrait de la page 150)
Le travail, toujours et encore
Il était sérieux ; il ne parlait jamais pour remplir le temps. Ce temps vide, il ne le possédait pas, étant toujours occupé, pressé comme par nature, comme s'il savait son échéance proche. Oh non ! Grand-frère ne poussait pas le temps avec l'épaule. Il travaillait sans discontinuer, n'importe où, avec les simples moyens dont il disposait : un crayon et du papier. Je me souviens de ses paquets de tabac à rouler, à l'époque où il fumait : vides, il les conservait, parce qu'ils étaient tous emplis de notes en français, de mots et d'expressions en kabyles.
Il parlait et agissait à bon escient, utilement. Pour lui, tout devait servir à quelque chose, tout devait viser à l'efficacité, la moindre parole, la moindre action, le rire même.
« Rien n'est gratuit ! » Rappelait-il à tout moment.
Et cette phrase allait bien au-delà de sa signification matérielle. Elle ne disait pas seulement que l'on doit tout payer d'une manière ou d'une autre, mais encore, que l'o doit mettre à profit tout ce que l'on fait ou ne fait pas.
La cité des roses, roman posthume de Mouloud Feraoun. Guerre et amour dans Alger.
La cité des roses, roman de Mouloud Feraoun, 170 pages, éditions Yamcom, Alger, année 2007.
C’est avec un grand soulagement que le personnage principal de ce roman posthume de M. Feraoun, appelé l’instituteur, quitte, en pleine guerre d’Algérie, l’école située dans un village de montagne, en Kabylie, où il enseigne jusqu’à sa mutation salutaire. Soulagement d’avoir désormais quelque chance d’échapper avec sa femme et ses enfants aux dangers de la guerre : brimades, tortures, emprisonnement et la mort qui a déjà fauché tant de gens de sa connaissance qu’il a acquis la certitude que, en restant dans ce village, son tour viendra tôt ou tard.
Il est muté comme directeur d’une école primaire d’un quartier arabe – comme on disait alors- de la proche banlieue d’Alger. Un quartier enfoncé dans la misère et assailli par la guerre comme tant d’autres de ses semblables. Avec des enseignants, tous européens, la tâche n’est pas facile malgré l’avantage que lui donnent son expérience et, à l’opposé, l’ignorance de débutants de ses jeunes collègues qui, pour la plupart, ont accepté leur affectation faute de pouvoir choisir un établissement mieux situé.
Parmi ces enseignants, Françoise, une jeune et belle femme arrivée récemment de métropole pour suivre son mari cadre d’entreprise. A la différence des autres, elle s’attache autant à bien faire son métier qu’à bien connaître les conditions sociales, évidemment catastrophiques, de ses élèves.
Au fil des jours, des semaines et des mois, un amour de plus en plus fort pousse le directeur et Françoise irrésistiblement l’un vers l’autre. Au commencement muet, il s’exprime par l’échange épistolaire, puis la parole et enfin le contact physique. L’éclosion de leur amour est ralentie, mais sans doute pas empêché, au contraire, par la cour assidue que fait à Françoise, M.G, militant ultra de l’Algérie française, le seul ouvertement méprisant envers le directeur. En cours d’année scolaire, soupçonné d’appartenance au mouvement pour l’indépendance, le directeur est arrêté et interrogé durant une semaine. A son retour à son poste, il s’aperçoit que Françoise et M.G ont eu une liaison durant son absence et fait à cette dernière une terrible scène de jalousie. Il apprend un peu plus tard qu’il doit ses ennuis avec l’armée à un acte de délation de M.G, son « ennemi intime » à un triple titre, ce dernier étant ultra en politique, concurrent par ambition professionnelle et rival en amour.
Leur amour donne l’impression – certainement voulue par l’auteur- de suivre étape après étape l’évolution de la situation politico-militaire. Il connait son summum avec l’épisode de la tentative de fraternisation entre les deux communautés et sa consommation sexuelle juste après un attentat à la bombe avec son effet traumatique paradoxalement désinhibiteur des freins moraux inculqués au directeur.
L’intensification de la guerre, la montée des courants ultras au sein de la communauté européenne aggrave encore plus la situation politico-militaire. Avec le retour en France de Françoise, la séparation est, pour le directeur, définitive. Elle sonne comme une annonce de l’autre séparation, celle de l’Algérie et de la France. Reste en partage, comme un précieux bien indivis, l’amour éternel dont l’éclat indélébile est occulté aux yeux de certains par les lueurs aveuglantes des haines et des rancœurs.
Extraits choisis de « La cité des roses »
« La Cité des Roses »
Le spectacle était pénible et l’instituteur regardait de tous ses yeux cette gigantesque verrue que lui découvrait aujourd’hui la capitale parce qu’elle s’apprêtait à l’accueillir pour de bon et avait décidé peut-être de plus rien lui cacher de ce qu’elle dissimule habituellement aux visiteurs qui l’aborde par le large ou par les grandes artères côtières, à qui elle offre les boulevards spacieux, les immeubles imposants aux architectures compliquées, élégantes ou audacieuses, tout le luxe, toute l’animation d’une ville moderne, occidentale, baignant dans la clarté de l’orient, le soleil et le ciel pur que continue indéfiniment la mer bleue, à peine ridée.
Non, ce que voyait l’instituteur, c’était un affreux bidonville où l’on devinait le grouillement d’un peuple misérable et hostile qui se drapait dans ses bâches, ses roseaux, ses vieilles planches et ses tôles rouillées comme dans u n manteau d’Arlequin et menaçait de ses ordures pour se soustraire à toute curiosité déplacée, à toute sympathie hypocrite. Cette protubérance insolente, accolée aux confins sud du territoire de la commune, se dissimulait au flanc d’un crête boisée qui domine la baie d’Alger, offrait au coup d’œil l’un des meilleurs tableaux qui se puisse voir par ici. Aussi, y a-t-on installé un observatoire, un fort avec blockhaus et d’immenses pylônes de la radio télévision. A l’orée du bois, lequel sans arrière-pensée s’appelait « Cité des Roses » et l’instituteur venait d’y être nommé pour exercer ses fonctions. Il arrivait de la montagne.
(Pages 13-14)
La fuite de l’instituteur
Toutes les écoles où il avait semé ce savoir aussi indispensable que le pain quotidien et qui pourtant continuait d’être un luxe dans ce pays avaient brûlé l’une après l’autre. On avait beau crier au sacrilège, les crieurs avaient tout fait pour que les sanctuaires fussent violés, que ce savoir aussi indispensable que le pain parût du pain amer, un aliment empoisonné qu’on se mit à cracher avec rage. L’école devint un lieu prohibé, le français une langue maudite, l’instituteur un suspect qu’il fallait surveiller de très près. L’instituteur n’était pas un traître mais un hybride. Personne n’en voulait plus, il était bon pour le couteau, la mitraillette ou tout au moins la prison. Lui, bravement, avait choisi la fuite. Il s’en alla sous les huées. Avant de le laisser sortir, les soldats fouillèrent de fond en comble ses bagages et lui prirent quelques livres.
(Pages 17-18)
Françoise (1)
Précisément, ce qui déroutait, c’était cette chaleur humaine qu’on sentait venir d’elle et qui allait indifféremment vers tous, comme si elle n’avait pas encore d’objet précis, attendant paresseusement que l’un ou l’autre se donnât la peine de la fixer. Il fallait être réceptif pour de s’en apercevoir. Mais ceux qui captaient cette appel en étaient troublés et honteux. On dirait que Françoise leur avait découvert, dans un geste maladroit, une fascinante intimité qu’il n’avait pas le droit de violer. Sur deux d’entre les hommes, l’attrait de la jeune femme s’exerçait visiblement et, lorsqu’elle s’en aperçut, elle fut sans doute la première à s’en étonner. Elle ne songea à cacher ni son étonnement ni ce bonheur nouveau qui l’envahissait insidieusement et qu’elle ne s’attendait guère à trouver à la cité des Roses. Son petit visage expressif reflétait toutes les émotions, de même que son regard clair qui se posait sur les êtres, direct comme un soleil lumineux. On devinait en elle, avec cette soif de bonheur, la spontanéité d’une gamine mais on était sûr, en même temps, de son honnêteté, de sa loyauté et, en face d’elle, on se sentait intimidé.
Telle apparaissait Françoise à M.G et, surtout, au directeur. Le directeur la trouvait digne d’être aimée. M.G, habitué aux bonnes fortunes, était décidé à lui faire la cour.
(Page 26)
Françoise (2)
D’instinct, elle était du côté des faibles, des opprimés, se sentait de leur bord et allait toujours vers eux. Ici, ça serait pareil. Dès la fin du premier mois, elle avait surmonté ses appréhensions et s’attachait à la cité. Quant à ses élèves, ils commençaient à s’ouvrir, à se confier à elle, à abuser de sa bonne foi, à devenir exigeant en réclamant toujours davantage d’intérêt, toujours plus d’affection dont ils paraissaient assoiffés. Elle était décidée à se dépenser, à se fatiguer, à se tuer pour eux : ils la rendaient heureuse.
Lorsque des esprits avertis la mettaient en garde contre un enthousiasme trop facile et évoquaient la situation dramatique où se débattait l’Algérie, en soulignant que l’œuvre de l’école elle-même, pourtant incontestable, était remise en question, par ceux-là mêmes à qui elle avait profité, alors que précisément elle n’avait porté que des fruits amers pour ceux qui l’avaient généreusement entreprise, elle répondait que cela la dépassait, que ses élèves étaient malheureux, qu’ils avaient besoin d’elle, qu’elle les aimait bien et ne doutait pas qu’elle être payée de retour. Elle ne voyait pas plus loin, le reste ne la regardait pas.
(Pages 31-32)
La guerre à l’intérieur de l’école
Chaque jour, la guerre s’infiltrait à l’intérieur de l’école comme une encre rouge et boueuse dans laquelle il fallait patauger constamment. Quand les maîtres arrivaient vers huit heures, ils l’apportaient dans la poche extérieure du veston, à la première page des quotidiens du matin, elle était dans le regard, eu fond du cerveau, dans le cœur et souvent remontait au visage pour l’assombrir ou lui donner d’autres teintes dont aucune n’exprimait la pitié mais toutes confusément la colère à ses différents degrés. Si elle venait sur les lèvres, au cours d’une conversation, les lèvres cessaient de sourire. Chaque jour, on la voyait passer motorisée et casquée de fer, fracassante et orgueilleuse. Tous les vendredis, la guerre accompagnait de nombreux élèves pour rappeler aux maîtres qu’ils faisaient la classe aux enfants de leurs ennemis. Et les enfants demandaient une autorisation d’absence pour aller rendre visite au grand frère dans sa prison, au père dans le camp d’ébergement, quand ce n’était pas pour accompagner la mère à une œuvre de bienfaisance présidée par la femme d’un général. Parfois l’enfant manquait les cours pour pleurer l’un de siens qu’on venait d’abattre ou qu’une grenade avait déchiqueté, par hasard, au coin de la rue voisine, il envoyait un mot d’excuse à son maître. Ces choses vous poursuivaient jusqu’au soir et le lendemain, ça recommençait. On ne pouvait pas s’empêcher d’y penser, on évitait difficilement d’en parler. Mais, lorsqu’on en parlait, on était rarement d’accord.
(Page 43)
Françoise et le directeur
D’ailleurs, je l’ai toujours attendue impatiemment car je me suis bien attaché à elle. Chaque matin, il fallait qu’elle soit là pour que je prenne goût à mon travail , je veux dire, pour faire semblant de m’intéresser à ma tâche tout en pensant sans cesse à Françoise que j’allais voir sous le prétexte le plus futile. Notre dialogue s’engageait à huit heures, se terminait à dix sept heures sur des points de suspension ; un dialogue de fous, fait de questions, de bribes de réponses, de demi aveux, de colères rentrées, de disputes vite allumées, aussitôt éteintes, de regards confiants, de sourires heureux ou tristes qui s’accordaient rarement avec nos paroles, un dialogue en tronçons une amitié en morceaux, une poussière d’amour qu’il eût fallu avoir le temps de rassembler et de tremper pour en faire une pâte à pétrir. Parfois, nous nous trouvions, le soir, les nerfs à bout, mécontents l’un de l’autre et nous rentrions chez nous, préoccupés par la seule idée de nous revoir.
(Pages 58-59)
Carnets rouges
Depuis le 20 mars, j’avais décidé de tenir un carnet rouge , où chaque soir, je lui faisais de déclarations enflammées. Ce carnet devait être secret. Un jour, je le lui ai fait lire. Elle en a été scandalisée. Puis je me suis remis à écrire et à le lui proposer de temps à autre. Elle ne l’a jamais refusé si bien qu’elle a pu suivre ligne après ligne le développement de ma passion. Ces semaines d’agitation populaire où l’espoir puisait sa force dans une fureur véhémente qu’on avait eu du mal à empêcher d’éclater et qui eût été capable de déclencher le plus effroyable des drames, nous avaient, pour ainsi dire, unis intimement comme si chacun de nous était pour l’autre un refuge providentiel qui l’isolait d’un insupportable tintamarre, un abri inviolable d’où il pouvait jeter un regard amusé sur une foire gigantesque et ses tonitruants matamores. Mais elle voulait à son tour que je la connaisse tout à fait. Alors, elle m’a demandé un autre carnet rouge et elle s’est mise à le remplir. A partir de ce jour-là, nous échangions nos carnets avec les messages que nous étions destinés.
(Page 76)
M.G
M.G est un grand garçon au regard perdu et au sourire hautain. Lorsqu’il tend la main aux hommes, ses collègues, il semble leur offrir un cadeau inespéré qu’aucun d’entre eux ne mérite. Quand il s’approche de jeunes dames, il arbore son sourire séducteur irrésistible et les salue confidentiellement comme s’il y avait entre elles et lui une longue intimité tissée de vieux secrets. Puis il va se mettre à l’écart, dédaigne nos conversations superficielles, et attend, sombre et inspiré, que l’une ou l’autre se détache de notre groupe pour aller le rejoindre. Alors son visage s’illumine. Ils se mettent à faire les cent pas et parviennent à se comprendre au sein de l’étourdissante cohue d’élèves d’où l’on voit émerger leurs têtes.
M.G et un français d’Algérie d’origine indéterminée. Je lui en veux non pour cela mais plutôt pour une certaine assurance dogmatique qui lui dicte sa conduite vis-à-vis des indigènes. Il y a par exemple sa promptitude à tutoyer les parents d’élèves, hommes ou femmes, sa manie d’émailler son langage d’expressions arabes plus ou moins de circonstance, jusqu’au jour où j’ai décidé de lui répondre en un pseudo berbère de mon invention après lui avoir conseillé de se servir du langage de ses aïeux.
(Pages 94-95)
Pour l’amour de Françoise
Là aussi, je suis incapable de dire exactement ce qui s’est passé. Pour moi, Françoise seule existait en cette fin de printemps éclatante où une douce euphorie plongeait les Français d’Algérie, de France et du monde dans un songe magnifique de grandeur et de foi retrouvée. Les comités de Salut Public multipliaient les démonstrations de force, occupaient tous les rouages de la capitale, s’emparaient de tout le pays, s’intéressaient à tout et à tous, entraînaient dans leur enthousiasme les plus sceptiques et le plus indifférents ne doutaient plus de personne et vous empêchaient de douter de vous-même. Mais pour moi, il n’y avait plus que Françoise. C’est alors qu’il parut opportun à M.G, officier U.T. d’aller me signaler à l’autorité militaire. Il signalait mon peu d’empressement à hisser le pavillon au dessus de la cité. Il signala les cris séditieux, les chants subversifs et arabes que les gosses entonnèrent un jour pour faire « râler » les maîtres, il précisa que je pouvais être chef de cellule FLN et demanda qu’une enquête serrée fût entreprise sur mes activités suspectes autant que clandestines.
Après le sérieux avertissement, à moi administré, au début de l’année, l’affaire pouvait être très grave mais je gardai un sang froid exemplaire, digne seulement d’une conscience pure ou d’un courage éprouvé. A vrai dire, si je ne m’effrayai ni ne me démontai, c’est que seul pouvait m’intéresser ce qui venait de Françoise. Tout le reste ne m’impressionnait plus, ne semblait plus me concerner. Je me tirai aisément d’affaire et n’en éprouvai aucune agréable surprise, aucune légitime fierté, aucune reconnaissance pour la mansuétude des enquêteurs.
(Pages 142-143)
L’attentat
La grenade a éclaté juste en face de chez elle, dans un café maure. J’y suis arrivé un quart d’heure après. Un pauvre bougre gisait sur le trottoir, déjà envahi par la teinte cireuse de la mort. Il ouvrait et fermait automatiquement la bouche et la mort lente, lente, tournoyait autour de nous comme si elle avait quelque répugnance à s’emparer de sa victime. Il était gros, un peu trapu, correctement vêtu d’une chemise blanche portant au beau milieu une large fleur de sang rose ; les pans de son manteau étaient ouverts, ses pieds et ses mains, indifférents, goûtaient déjà visiblement le suprême repos. Il n’y avait que cette bouche qui s’ouvrait, se fermait, indifférente aussi, semblait-il.
Un autre, plus loin, au milieu de la chaussée, baignait dans une mare de sang plus sale, presque noir. Il avait la tête piquée au sol, un bras complètement retourné sur le dos, les jambes recroquevillées étaient couchées l’une sur l’autre. Il s’était peut-être agenouillé avant de s’affaisser tout à fait et, maintenant, ses articulations refusaient de jouer. Celui-là aussi se raccrochait à la vie par un fil dérisoire et tenu que la mort avait peut-être oublié de rompre.
(Pages 155-156)
Après l’attentat
Françoise ne m’a pas laissé le temps de sonner. La porte s’est ouverte devant moi et nous nous sommes trouvés face à face. Elle était pâle comme une figure de marbre. Et me regardait fixement, les lèvres serrées. Moi-même, j’avais la vue brouillée, un énorme sanglot qui ne voulait pas sortir me nouait la gorge, je devais ressembler à une bête traquée devant laquelle s’ouvrirait tout à coup l’issue salutaire, inespérée. Je me suis approché d’elle, je l’ai enveloppée dans mes bras et je serrée sur ma poitrine. Je la sentais toute contre moi, son genou s’insinuait entre les miens, elle avait fermé les paupières. Je lui ai donné plusieurs baisers, lentement, l’un après l’autre, en comptant presque. A un moment, elle a ouvert les yeux et souri, je me suis penché sur sa bouche qu’elle m’a tendue gentiment…
(Pages 156-157)
Le départ de Françoise et de son mari
Lorsque j’ai appris qu’ils avaient définitivement quitté l’Algérie, je n’ai éprouvé qu’une légère contrariété. J’ai dit adieu au quartier et jusqu’ici je n’y suis pas encore repassé. A cette légère contrariété se mêlait un sentiment de délivrance et de légitime orgueil. Je me disais :
- Bon, Françoise est partie. Je ne la reverrai sans doute jamais. Pourtant elle est toujours à moi. Elle aura beau coucher avec tous les hommes, se faire putain, rien ne pourra effacer cette nuit, rien ne pourra effacer une année entière de bonheur et d’amour.
Tout ce que j’avais souffert à l’attendre, toutes les insomnies, nos crises de larmes ou de nerfs, nos disputes, tout ce qui nous avait fait mal ensemble ou l’un par l’autre séparément, c’était cela l’amour et le bonheur. Eh ! bien, de ce bonheur, de cet amour, j’en avais assez. Non pas que j’en fusse déçu, encore une fois j’étais parvenu à en saisir le meilleur instants et, cet instant était passé, il n’allait don pas revenir mais je savais qu’il s’inscrirait en moi, marquerait mon existence ferait physiquement partie de moi non pas comme une cicatrice définitive mais plutôt comme une source apaisante de consolation et de rêve. Une source qui ne tarirait jamais, un organe supplémentaire de sécrétion bénéfique dont une chance exceptionnelle m’aurait pourvu.
Le maître de Tala, roman de Saïda Azzoug-Talbi. Le parcours exemplaire d'un instit des petits indigènes
Le maître de Tala, roman de Saïda Azzoug-Talbi, préface de Mouloud Achour, 178 pages, Editions Dahlab (Alger), année 2009.
Cette œuvre de Saïda Azzoug-Talbi, écrite dans un français classique aussi clair qu’élégant, donc agréable à lire, tient à la fois du roman historique, du récit de souvenirs, des mémoires et de la biographie. Cependant, l’impression permanente de vérité et d’authenticité qui s’en dégage font penser à une biographie, celle du maître de Tala, Amar, même si des épisodes de sa vie, par exemple sa condition d’orphelin de père et ses liens avec sa famille élargie, n’ont pas été abordés.
La richesse du contenu alliée à la concision – mélange heureux et bien rare de nos jours – permet aux lecteurs d’apprendre et, pour les générations antérieures à l’indépendance, de se remémorer.
Nous apprenons beaucoup sur les conditions concrètes dans lesquelles les premières générations d’algériens - dits indigènes à l’époque- ont reçu une enseignement et une formation dans les écoles françaises ouvertes à partir de la fin du 19ème siècle, puis leur rôle dans la diffusion de la science et la culture occidentale ainsi que de la langue française à des générations de petits écoliers, parmi lesquels l’auteure. Nous mesurons aussi combien la société traditionnelle algérienne, déjà largement déstructurée et détruite par l’occupation, est constamment attaquée dans ses derniers retranchements par la colonisation ainsi que par les ondes de choc des crises économiques et politiques cycliques, telle, à l’époque des faits, celle de 1929.
Le mode de vie traditionnel, celui que, par exemple, les gens de ma génération – nés dans les années 1950 – connaissent par leurs vagues souvenirs personnels et surtout par les dires des générations antérieures – parents et grands parents – est présenté avec vérité et exactitude.
En fait, « Le maître de Tala » traite en quelque sorte de l’histoire des grands et arrières grands parents de nous tous, algériens des temps présents même si le destin d’Amar le maître d’école, est exceptionnel. En effet, petit orphelin de père ayant grandi dans la misère extrême de l’époque grâce à l’amour et la combativité d’une mère (appelée « l’aïeule »), il entre à l’école sur décision de cette dernière et réussit au-delà de toute espérance :
- en obtenant son certificat d’études primaires,
- en devenant maître-élève de l’Ecole normale de Bouzaréah,
- en entamant brillamment sa carrière de maître d’école pour petits algériens, dits indigènes,
- en étant mobilisé dans l’armée française au cours de la première guerre mondiale et en revenant vivant et indemne au pays,
- en se consacrant pour la suite de sa carrière à l’éducation de générations d’élèves, dont une partie dans l’école à classe unique de son village natal, Tala N’Tazart.
Excellent, c’est le qualificatif principal qui définit d’Amar, le maitre de Tala ; il l’est en tant que fils, élève, maître, mari ; en tant que kabyle et algérien également car, pas assez convaincu par le matraquage idéologique des colonisateurs, auquel nombre d’autres personnes comme lui ont finit par succomber, il n’a jamais renié sa culture, ses ancêtres et son pays, l’Algérie.
Une critique sur le contenu de l’œuvre me vient cependant à l’esprit. Il s’agit du manque d’informations sur les façons de s’habiller, les règles de vie en famille et en communauté et les luttes politiques, culturelles et syndicales menées par les algériens dits indigènes. Cette critique ne diminue pas à nos yeux la valeur littéraire indiscutable de « Le maître de Tala ».
Extraits choisis de « Le maître de Tala »
Les aliments
La farine de glands, de sorgho et de l’orge grillé étaient des aliments de base des populations déshéritées. Avec ces farines mélangées, quand la nature était généreuse, avec du cresson, de l’ail sauvage, de la menthe pouliot, d’un peu de graisse séchée, précieusement gardée d’Aïd en Aïd, l’aïeule confectionnait des crêpes qui tenaient au corps en hiver. Ces crêpes avaient un goût délicieux surtout avec un peu d’huile d’olive - Délice rarissime en ces temps de disette.
(Extrait de la page 23-24)
L’école publique
L’enseignement dispensé par madame Grégoire porta très tôt ses fruits. Des esprits aigus furent détectés, il fallait se rendre à l’évidence : il y avait une avidité d’apprendre surprenante, la compétence avérée de la maîtresse fit le reste. Rapidement : l’alphabet, la lecture, les opérations de calcul élémentaires devinrent familiers. Les enfants, plus confiants, éprouvèrent du plaisir à ses rendre à l’école. Ceux qui avaient pleuré le premier étaient devenus gais, un tantinet indisciplinés. Pendant le cours, un silence total planait, la maîtresse n’élevait jamais la voix.
(Extrait de la page 28)
Les français dits de France
L’année suivante se déroula aussi bien à l’école d’Ighil Bouamas. Les époux Grégoire avaient adopté Amar au point de le garder chez eux après la classe. Ils le faisaient travailler avec leur fils, ainsi il améliorait et enrichissait son langage. Les efforts entrepris donnèrent des résultats satisfaisants pour les deux enfants qui devinrent les meilleurs amis du monde des années durant.
Amar découvrit le monde des français dits de France : sans animosité envers les indigènes, compréhensifs, humains allant vers les plus humbles. Leur comportement était fait de simplicité, chez eux, il n’y avait ni gaspillage ni luxe ostentatoire. Toutes ce images restèrent gravées dans l’esprit de l’enfant. Ce furent des années dont il se souvint longtemps, même quand son niveau de vie s’améliora.
(Extrait des pages 32-33)
La Casbah d’Alger
Comme il était convenu, l’oncle emmena Amar se promener dans la Casbah ; lui-même désirait fortement découvrir ces minuscules venelles aux noms étranges : rue du Sphinx, de la Lune, de la Bombe, de la Grenade, de la Grue, de la Mer rouge, des Pyramides, du Divan, des Gétules, Médée, Caton… et tant d’autres encore, qui devenaient de plus en plus inattendues dès qu’on s’enfonçait au cœur du quartier.
Le charme de l’architecture, à chaque détour, exerçait comme un sortilège. Les balcons et les terrasses étagées étonnaient l’étranger.
La noria de petits ânes gris, patients leurs chouaris remplis d’ordures descendant vers un point de collecte en vue de leur évacuation achevèrent de les ravir. La Casbah, lavée à grande eau, devenait vers le soir l’un des quartiers le plus propres de la capitale. Elle concurrençait en cela la Casbah de Tunis réputée en Afrique du Nord.
(Extrait de la page 47)
Deux villes dans la ville
Le quartier européen était totalement différent de la Casbah : sauf exception dans sa partie inférieure. La rue Bab-Azoun n’était pas une rue du quartier européen bien qu’elle ne fût plus tout à fait une rue typiquement arabe en dépit de ses arcades et de ses gargotes.
Au lever du jour, tôt le matin, des travailleurs indigènes se rendaient au port et aux chantiers. Des femmes de ménage en voiles blanc s prenaient le chemin des domiciles européens.
Les deux villes étaient également différentes du point de vue architectural. Les européens avaient ramené d’autres types de construction : ils avaient réalisé une ville avec des larges avenues, de rues droites, éclairées la nuit comme en plein jour. Les immeubles, très hauts, comportaient plusieurs étages avec de larges fenêtres laissant pénétrer le soleil et la lumière de la Méditerranée.
La ville européenne : c’était aussi l’exubérance le verbe haut, le bruit, les enseignes lumineuses, le tintamarre, les flots de musiques, les flonflons qui s’échappaient des cafés jusqu’à une heure très avancée de la nuit.
(Extrait de la page 51)
Apartheid à l’école normale
L’établissement dénommé Ecole normale comprenait trois établissements distincts :
- L’Ecole normale française réservée aux élèves –maître européens recrutés sur les mêmes critères que les élèves –maîtres indigènes pour un cursus de même durée.
- Le Cours normal des indigènes où étaient formés les élèves –maîtres. Indigènes, après le délai requis, à sortir en qualité d’adjoints de ceux de l’Ecole normale française : jamais un élève-maître indigène ne fut le directeur d’un élève –maître européen en dépit des résultats parfois probants du premier.
- La troisième section appelée « section spéciale d’adaptation « recevait des élèves –maîtres formés en métropole et des bacheliers qui venaient passer une année à la Bouzaréah. Là, ils bénéficiaient d’un programme d’enseignement adapté aux enfants indigènes et de rudiments de la langue arabe.
Les maîtres d’Amar, les époux Grégoire de Franche-Comté étaient issus de ce corps, qui avait su donner aux indigènes un enseignement de qualité.
(Extrait des pages 53-54)
Colonisation des esprits
Le Cours normal devait créer un corps intermédiaire d’indigènes pour faciliter les relations entre les colons et les indigènes.
Le message ne fut pas reçu de la même façon chez les colons : il y eut une levée de bouclier pour dénoncer cette perte de temps, d’argent et pire c’était un luxe inutile voire dangereux.
Pris entre ces deux politiques ou visions du monde contradictoires, les élèves-maîtres furent des victimes expiatoires. La République n’ayant pas annulé leur formation, malgré les réactions des colons qui se vengèrent à leur manière. Les élèves-maîtres, à leur insu, absorbaient l’idéologie scolaire coloniale par toutes les voies : le savoir diffusé, le costume imposé, la langue de travail et de communication, l’architecture écrasante du bâtiment du Cours normal et pour agrémenter le tout un régime alimentaire exquis.
(Extrait de la page 61)
Mourir pour l’Alsace et la Lorraine
Chacun commenta la nouvelle à sa manière. Selon l’opinion générale et unanime des indigènes, ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient envoyer leurs enfants se faire « trouer la peau » pour des gens qu’ils ne connaissaient, ou plutôt dont ils ne connaissaient que les défauts, et pour des raisons qui ne les concernaient pas. Après tout, qu’étaient pour eux l’Alsace et la Lorraine ? Ils n’en avaient que faire, quand eux et les leurs crevaient de faim !
(Extrait de la page 75).
Notre mère l’Algérie
Il n’avait pas de responsabilités familiales particulières puisqu’il était célibataire. Le matraquage psychologique enduré au cours normal faisant de la France sa mère patrie ne l’avait jamais, totalement, convaincu. Au plus profond de lui-même, il n’avait qu’une seule conviction : sa mère était l’aïeule, au dessus d’elle se trouvait l’Algérie : celle de ses Ancêtres, alors pas de contes à dormir debout !
Vis-à-vis de cette guerre, il éprouvait des sentiments ambivalents. S’il fallait y aller, il irait, ce ne serait pas de gaieté de cœur. Il n’aurait pas le courage de déserter de peur de mettre son groupe familial en danger, il y avait un sentiment de lâcheté qui le gênait.
(Extrait de la page 77)
La colonisation triomphante
La célébration du Centenaire dura longtemps, elle donna à de manifestations grandioses, à des scènes de joie indécentes. Les flonflons furent relatés dans tous les journaux de la Colonie, dans la « Dépêche quotidienne » dont quelques ramenés par des collègues ou de parents d’élèves arrivèrent à Tala. De tous les journaux, celui-ci était le moins virulent, bien qu’il fût loin, très loin d’être libéral.
Amar quittait rarement Tala, en outre, il n’avait aucun plaisir à assister aux manifestations insoutenables de la colonisation triomphante, là où même des notables indigènes s’étaient joints pour applaudir et louer à l’unisson l’œuvre civilisatrice de la France.
Les numéros de la « Dépêche quotidienne » qu’il avait lus passaient sous silence la crise économique mondiale qui allait changer la face du monde.
Cette crise s’était produite à la bourse de New York, puis à celle de Paris après la chute de l’un des plus grands spéculateurs. -Bien sûr- ça paraissait loin !
Elle allait sonner le glas de l’économie française avant d’atteindre l’Algérie. La société traditionnelle indigène fut la première entraînée dans la spirale.
(Extrait de la page 160-161.)
Si Diable veut, roman de Mohamed Dib. le Diable a-t-il définitivement triomphé des hommes ?
Si Diable veut, roman de Mohammed Dib, éditions Dahlab (Alger), 230 pages, année 2009.
Ce roman est un voyage à l'intérieur de quelques unes des pires menaces auxquelles nous sommes ou croyons être exposés. Ces menaces, nous en avons une peur tellement intense que le commun des mortels arrive rarement à en parler et, lorsqu'ils y arrivent, c'est juste pour rappeler leur survenance possible. Ces menaces et les peurs qu'elles induisent sont profondément ancrées dans l'esprit des habitants des terroirs algériens et maghrébins. Et certainement ailleurs que dans nos pays afro-méditerranéens avec, sans doute, un autre habillage symbolique.
Il faut dire que la géographie humaine intéresse accessoirement Mohammed Dib. Ses personnages et leurs décors peuvent être situés dans n'importe quelle région du Maghreb. Seules des données de géographie naturelle, tel le figuier, permettent de situer le cadre de l'histoire dans l'extrémité nord des pays maghrébins.
En fin connaisseur de la culture orale du pays profond, Mohammed Dib nous en expose magistralement les moindres détails par le biais des monologues de ses personnages, surtout des deux sages, Hadj Merzoug et Lalla Djawhara, mari et femme, à la fois pénétrés des vérités des êtres et des choses de notre monde visible et réceptifs aux sens des manifestations du monde invisible, souvent menaçantes et terrifiantes. Cette culture orale, fortement imprégnée de fantastique et d'ésotérisme, résultat d'un mélange syncrétique de croyances religieuses et de mythes païens, l'auteur nous la présente dans un style emprunté à la musique et à la structure des parlers maghrébins. Ce qui donne miraculeusement à la langue française un habillage adapté aux caractères intrinsèques de l'oralité berbéro-arabe.
Les menaces et les peurs collectives qui remontent du fond de notre inconscient sont, dans le cas du roman « Si Diable veut », la sécheresse, d'une part, et les chiens retournés à l'état sauvage, d'autre part. L'auteur situe les deux menaces au même moment et même endroit. Certainement pour donner à l'intrigue une plus grande intensité dramatique. Et plus encore, pour montrer l'état de déstructuration d'une société traditionnelle attaquée d'un côté par une nature « révoltée » représentée par les chiens retournés à l'état sauvage revenu comme pour régler leur compte à la communauté égarée de Tadart (village en langue tamazight) et de l'autre la culture occidentale à prétention universelle rendue indifférente par sa toute puissance au devenir des cultures locales.
L'apparition simultanée des deux menaces n'est pas à notre sens le pur fruit des hasards de la création romanesque. Cette conjugaison des périls sert à situer exactement la position de la communauté de Tadart coincée qu'elle est entre deux cultures et, donc, deux visions du monde : la culture locale qui a longtemps servi à entretenir l'équilibre entre la nature et les hommes mais qui devient inopérante face aux avancées de la culture impériale, à vocation dominatrice et des hommes et de la nature. Désarmée face à cette coalition de facteurs défavorables, la communauté de Tadart imagine des solutions qui s'avèrent n'être que des palliatifs :
- Dans l'espoir de mettre fin à la sécheresse, faire exécuter à l'intérieur du sanctuaire du saint de Tadart, Sidi Afalku, le sacrifice par égorgement au couteau tourterelles par Ymran, le jeune adolescent émigré de retour au pays mais complètement intégré au mode de vie européen. Malgré la présence de Safia, la rousse adolescente devenue Tawkilt (être invisible), chargée de l'assister, Ymran refusera de se plier à ce rite « barbare ».
- Tenter, à l'initiative de Hadj Merzoug, moudjahid de la guerre de libération nationale, d'éloigner temporairement les meutes de chiens sauvages en tuant une partie lors d'une attaque des hommes de Tadart en possession d'armes à feu.
Mohammed Dib veut-il nous signifier que le Diable a définitivement triomphé des hommes ?
Extraits choisis de « Si Diable veut »
Hadj Merzoug
Il en est passé du temps et Hadj Merzoug toujours : protégé par ma djellaba de laine brute, face à la porte ouverte, je me borne à regarder. J'y passe des heures. Elles ne me servent à rien, ces heures. Elles n'ont qu'à passer. J'ai couru après la vie et maintenant je ne cours plus. Elle m'a malmené la vie … autant qu'elle sait le faire. Je l'ai malmenée à mon touret j'ai gagné, si avec elle on croit avoir gagné à un moment ou un autre.
(Extrait des pages 07 et 08)
Yéma Djawhar
Yéma Djawhar dit : je vais, je trotte que je trotte, de-ci de-là, et ainsi de toute la journée, depuis tôt le matin. Il me semble n'avoir jamais fait autre chose. Sinon quoi : rester assise, les jambes croisées ? Abandonner la maison à elle-même ? De-ci de-là.
(Extrait de la page 09)
Ymran
Les raisons qui ont déterminé Ymran à revenir relèvent de ces raisons du cœur qui ne se disent pas. Il n'a pu les confier qu'au champ d'orge naissante, qu'à la haute solitude des alpages où, sitôt arrivé, il s'est jeté à corps perdu. Ses yeux, dès sa prime enfance, ne s'étaient ouverts que sur la détresse, la déréliction d'une banlieue où, en même temps que d'autres familles d'immigrés, la sienne avait échoué. Avec ses tours délabrées du haut desquelles ne se voient que des tours semblables, un univers maudit. Là, il a grandi, lui, mais ni la détresse ni la déréliction n'ont changé. Le pays d'accueil n'avait à leur offrir que cela.
(Extrait de la page 49)
La promesse
- Retourne au pays, mon garçon, avait-elle pris sur elle de dire.
Et il avait promis :
-Oui, mère.
- Cherches notre maison. Les voisins te la montreront. Et salues-la, même si elle n'est plus à nous.
- Oui, mère.
- Cherches ensuite la fontaine, et salues-la aussi. Elle se souviendra de moi.
- Je la chercherai, mère.
- Va visiter nos champs et dis à leurs figuiers et à tous les arbres que tu viens de la part de Zahra, qu'ils ont bien connue, tu me le promets ?
- Oui, mère. Je te le promets.
- Portes -leur aussi mon salut.
(…)
- N'oublie pas te faire monter ensuite le sanctuaire du saint protecteur Afalku. Embrasses-en la porte, dis que c'est pour moi que tu le fais et qu'il ne m'en veuille pas, si je l'honore de loin seulement, Dieu m'a vaincue.
- Je n'oublierai pas, mère.
- A toutes et à tous de chez nous, apprends-leur que ma dernière pensée a volé vers eux. Qu'eux aussi me pardonnent de les avoir quittés : c'était par ordre du Ciel : je n'ai rien renié. Promets-moi.
- Je promets, dit Ymran.
Et il pensa : « Elle sait. Elle va mourir dans quelques instants et elle le sait. »
- Pour l'amour de Dieu et de moi, fils.
- Oui, mère.
(Extrait des pages 62-63)
Safia, tawkilt
Ymran, au bord de la transe, dit : Une fille ? On n'aurait pas imaginé une tawkilt sous d'autres traits. On ne l'aurait pas supposée moins jeune, moins effarée, moins rousse, moins jolie, les cheveux moins ébouriffés ; le moins qu'on puisse espérer trouver chez une tawkilt.
Et il n'a aucun mal à reconnaître en elle, Safia, une fille de Tadart.
(Extrait de la page 75)
« Gens des nuages », récit de J.M.G Le Clézio, prix Nobel de littérature. La civilisation du désert
Gens des nuages, de Jemia et J.M.G Le Clézio, photographies de Bruno Barbey Editions Gallimard, collection folio, 2008, 151 pages.
J’avoue mon ignorance dès le départ : je ne connais pas l’œuvre littéraire de Jean - Marie - Gustave Le Clézio, prix Nobel 2008, si ce n’est indirectement par les articles que j’ai lu, il y a longtemps, dans « Le Monde des livres », supplément hebdomadaire du grand quotidien parisien, et dont je me rappelle vaguement le contenu sauf de l’idée générale que la critique en fait une figure singulière et solitaire dans l’univers littéraire hexagonal.
« Gens des nuages », récit de voyage, je l’ai lu récemment. Mon choix de ce livre n’est pas dicté par son importance dans l’œuvre de l’auteur mais plutôt par la destination de son voyage, Saguia El Hamra (traduit par « la rivière rouge »), une région du Sahara occidental qui donne, de prime abord, pour le Maghrébin que je suisi, un air de familiarité accentué par les photographies de Bruno Barbey qui illustrent le déroulement du voyage, étape par étape.
Le fait que le livre est aussi cosigné de Jemia, la compagne de JMG Le Clézio, dont la famille est originaire de Saguia El Hamra, a aussi éveillé ma curiosité, d’où mon désir d’en savoir plus.
Le Clézio et Jemia se rendent à Saguia El Hamra chargés chacun de sa mémoire personnelle ; pour l’un, sa connaissance des contrées désertiques d’Amérique, et pour l’autre, les réminiscences de son histoire familiale racontée par sa grand mère.
Le récit du voyage débute comme un guide touristique à une différence près : à part la localité de Smara, il est presque sans escale connue des voyagistes. A mesure qu’ils s’enfoncent dans le Sud, le récit s’apparente à un manuel de géographie physique, d’histoire et de préhistoire en remontant jusqu’aux premiers habitants du Sahara d’avant le désert, les noirs, suivis des berbères puis des arabes. Deux personnalités phares représentent la quintessence de l’investissement en capital spirituel par les habitants de Saguia El Hamra:
- Sidi Ahmed El Aroussi, qui a vécu au XVIème siècle, maître spirituel (soufi), originaire de Tunis, rebelle au pouvoir ottoman et fondateur de la tribu des Aroussiya (à laquelle appartient Jemia) de Saguia El Hamra ;
- Ma El Aïnine, maître spirituel et chef de la résistance aux armées d’occupation française et espagnole au XIXème siècle.
Deux idées essentielles caractérisent le rapport des « gens des nuages » (les Aroussiya et, peut-être, tous les gens du désert) : la vie en harmonie avec la nature et la liberté en tant qu’exigence de l’harmonie.
Les idées d’harmonie et de liberté ne peuvent que nous renvoyer à notre condition commune d’hommes modernes, « spécialisés », captifs de leurs vies étriquées consacrées au culte des objets marchandises.
Saguia El Hamra restera-t-elle toujours le pays de l’harmonie et de la liberté ? Les contrées « mondialisées » adopteront-elles un jour l’harmonie et la liberté ?