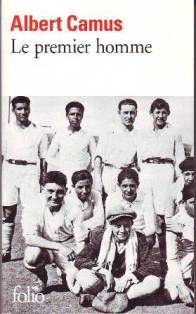Le premier homme, roman inachevé et posthume d'Albert Camus. L'autre fils du pauvre.
Le premier homme, d'Albert Camus paru aux éditions Gallimard (Paris), collection Folio, 380 pages, année 2009.
Force des témoignages
A défaut d'être un roman, tel que l'a projeté son auteur disparu prématurément des suites d'un accident de voiture, « Le premier homme » apparaît d'abord comme un témoignage de grande importance sur les conditions de vie au 20ème siècle de la frange la plus pauvre de la population européenne habitant le quartier de Belcourt d'Alger. Et la famille d'Albert Camus a fait partie de ce monde de misère et de dignité (les deux allant très souvent ensemble) qu'il nous décrit méthodiquement par cercle concentrique, du plus proche au plus éloigné.
Le premier cercle, c'est sa mère et son père. L'utilisation de la troisième personne lui permet de raconter sa venue au monde le jour même de leur arrivée à Mondovi (actuel Dréan, près d'Annaba) après un long et épuisant voyage depuis Alger. Nous saurons en lisant la suite du texte, que sa venue en ce monde est totalement imaginée faute de témoignages, à commencer par ceux de sa mère vivante mais n'ayant jamais pu dire grand-chose sur cette période de sa vie ainsi que sur son mari. Mobilisé quelques mois plus tard pour les combats de la 1ère guerre mondiale, il – le père d'Albert Camus - est tué à l'âge de 29 ans par un éclat d'obus reçu à la bataille de la Marne. L'arrivée à Mondovi et la venue au monde nous apparait comme l'un des chapitres les plus vrais et plus beaux. Beauté et vérité qui viennent paradoxalement du caractère fictif des détails de ces événements. Détails dont la création a permis à l'imagination et au style de l'auteur de s'exprimer pleinement.
Les autres cercles suivent l'un après l'autre: la famille du petit Albert (sa mère, sa grand-mère, ses oncles et ses tantes), ses petits camarades de jeux dans les ruelles, les terrains vagues, les caves abandonnées, la plage (« Les sablettes ») située en face de Belcourt, quartier « mixte » d'Alger où vivent côte à côte (et pas du tout ensemble) les deux communautés, l'européenne et l'autochtone, et enfin l'école. Il s'attarde particulièrement sur ses relations avec quatre familiers : sa mère, aimante et silencieuse, sa grand-mère, chef de famille sévère et autoritaire, son oncle Ernest, un bel homme, simple d'esprit et plein de joie de vivre, son instituteur, guide et père spirituel.
La fin des études primaires marque pour le petit Albert celle d'une période de son existence où sa vie est limitée aux horizons restreints de sa famille et de son quartier. Au lieu d'aller travailler pour soutenir les siens comme l'a voulu au départ sa grand-mère, suivant en cela l'usage dans son milieu social, il arrive, en raison de ses excellents résultats scolaires et avec l'aide de son instituteur, à passer avec succès l'examen d'entrée au lycée. Une fois au lycée, il commence à se détacher tant physiquement, l'établissement, où il passe la journée entière en demi-pension, est situé en quartier résidentiel, que moralement, les voies de la connaissance lui sont désormais grandes ouvertes, de son milieu de pauvres obligés de consacrer leur temps et leurs moyens à la lutte pour la survie.
Les témoignages de l'auteur s'arrêtent là, c'est-à-dire à sa période de lycée. Cela a pu lui paraitre suffisant pour expliquer son parcours exceptionnel d'écrivain, prix Nobel de littérature, dans la mesure où il est convaincu que sa réussite « de fils du pauvre », de surcroît orphelin de guerre, il la doit aussi à l'école publique comme certains petits arabes de sa génération. Il est également vraisemblable que sa disparition prématurée l'ait empêché de continuer son œuvre non seulement en termes de travail d'écriture - le constat est évident à ce sujet - mais de période de temps couverte par ses témoignages. En tout cas, ces deux hypothèses ne nous paraissent pas exclusives l'une de l'autre.
Cohérence entre les idées et les actes
Outre les éclairages sur ses conditions de vie et celles de son entourage, l'autre intérêt des témoignages est la qualité du regard rétrospectif porté sur les gens et les événements. Qualité du regard qu'il nous semble intéressant de comparer, fusse-t-il de manière très sommaire, au contenu de ses œuvres littéraires et au sens de ses positions politiques, surtout celle en rapport avec le statut présent et futur de l'Algérie. Il identifie deux cassures majeures dans la société coloniale : d'une part, la cassure entre les autochtones et les européens et, d'autre part, celle entre les pauvres et les riches parmi ces derniers. Ces cassures, signes parmi d'autres de la cruauté du monde pour le plus grand nombre, ont largement imprégné l'œuvre d'Albert Camus en y installant ce climat permanent de vide dans les existences. C'est du moins ce vide existentiel, attribut d'un monde sans âme et sans cœur, que nous avons constamment ressenti à la lecture, il y a maintenant plus de quarante ans, de deux de ses romans, « l'étranger » et « la peste ». Ce climat de vide résonne comme un écho à l'histoire de ces européens pauvres, à l'image de ses parents, obligés de consacrer la totalité de leur temps et de leur énergie à se battre pour survivre au jour le jour sans rien pouvoir consacrer à la dimension intellectuelle de l'existence, telle par exemple la pratique de la religion, catholique en ce qui les concerne.
Quant aux positions politiques d'Albert Camus, elles nous paraissent comme les reflets de son histoire personnelle de français d'Algérie de condition modeste ayant pris la posture de l'homme révolté appuyée par son statut d'écrivain et homme de culture. Il est à la fois contre le système colonial et contre l'indépendance de l'Algérie. Il est pour la justice en faveur des pauvres et des sans- voix, arabes et européens. Nous considérons qu'Albert Camus a su mettre en cohérence ses écrits et ses positions politiques avec ses principes d'homme épris de justice. Seule réserve (mais en est-il vraiment responsable ?) : l'impact limité de ses positions politiques auprès des populations tant européennes qu'autochtones depuis longtemps travaillées par des courants définitivement antagoniques, patriotisme algérien, idéologie des opprimés, contre racisme colonial, idéologie des oppresseurs.
Extraits choisis de « Le premier homme »
L'ile immense
Au dessus de la carriole qui roulait sur une route caillouteuse, de gros et épais nuages filaient vers l'Est dans le crépuscule. Trois jours auparavant, ils s'étaient gonflés dans l'Atlantique, avaient attendu le vent d'Ouest, puis s'étaient ébranlés, lentement d'abord et de plus en plus vite, avaient survolé les eaux phosphorescentes de l'automne, droit vers le continent, s'étaient effilochés aux crêtes marocaines, reformés en troupeaux sur les Hauts plateaux d'Algérie, et maintenant, aux approches de la frontière tunisienne, essayaient de gagner la mer Tyrrhénienne pour s'y perdre. Après une course de milliers de kilomètres au-dessus de cette sorte d'île immense, défendue par la mer mouvante au nord et au sud par les flots figés des sables, passant sur ce pays sans nom à peine plus vite que ne l'avaient fait pendant des millénaires les empires et le peuples, leur élan s'exténuait et certains fondaient déjà en grosses et rares gouttes de pluies qui commençaient de résonner sur la capote de toile des quatre voyageurs.
(Extrait de la page 13)
Le père mort à la guerre
Il revoyait sa vie folle courageuse, lâche obstinée et toujours tendue vers ce but dont il ignorait tout, et en vérité elle s'était toute entière passée sans qu'il ait essayé d'imaginer ce que pouvait être un homme qui lui avait justement donné cette vie pour aller mourir aussitôt sur une terre inconnue de l'autre côté des mers. A vingt-neuf ans, lui-même n'était-il pas souffrant, fragile, tendu volontaire, sensuel, rêveur, cynique et courageux. Oui, il était tout cela et bien d'autres choses encore, il avait été vivant, un homme enfin, et pourtant il n'avait pensé à l'homme qui dormait là comme à un être vivant, mais comme à un inconnu qui était autrefois passé sur la terre où il était né, dont sa mère lui disait qu'il lui ressemblait et qui était mort au champ d'honneur.
(Extrait de la page 35)
La mère
Quand il arriva devant porte, sa mère l'ouvrait et se jetait dans ses bras. Et là, comme chaque fois qu'ils se retrouvaient, elle l'embrassait deux ou trois fois, le serrait contre elle de toute ses forces, et il sentait contre ses bras les côtes, les os durs et saillants des épaules un peu tremblantes , tandis qu'il respirait la douce odeur de sa peau qui lui rappelait cet endroit, sous la pomme d'Adam, entre les deux tendons jugulaires, qu' il n'osait plus embrasser chez elle, mais qu'il aimait respirer et caresser étant enfant et les rares fois où elle le prenait sur ses genoux et où il faisait semblant de s'endormir, le nez dans ce petit creux qui avait pour lui l'odeur, trop rare dans sa vie d'enfant, de la tendresse. Elle l'embrassait et puis, après l'avoir lâché, le regardait et le reprenait pour l'embrasser encore une fois, comme si, ayant mesuré en elle-même tout l'amour qu'elle pouvait lui porter ou lui exprimer, elle avait décidé qu'une mesure manquait encore. « Mon fils, disait-elle, tu étais loin »
(Extrait des pages 68-69)
Algériens envoyés à la boucherie
Tout se passait là-bas en effet où les troupes d'Afrique et parmi elles H. Cormery, transportées aussi vite que l'on pouvait , menées telles quelles dans une région mystérieuse dont on parlait, la Marne, et on n'avait pas eu le temps de leur trouver des casques, le soleil n'était pas assez fort pour tuer les couleurs comme en Algérie, si bien que des vagues d'Algériens arabes et français, vêtus de tons éclatants et pimpants, coiffés de chapeaux de paille, cibles rouges et bleues qu'on pouvait apercevoir à des centaines de mètres, montaient par paquets au feu, étaient détruits par paquets et commençaient d'engraisser un territoire étroit sur lequel pendant quatre ans des hommes du monde entier, tapis dans des tanières de boue, s'accrocheraient mètre par mètre sous un ciel hérissé d'obus éclairants d'obus miaulant pendant que tonitruaient les grands barrages qui annonçaient les vains assauts. Mais pour le moment il n'y avait pas de tanière, seulement les troupes d'Afrique qui fondaient sous le feu comme des poupées de cire multicolores, et chaque jour des centaines d'orphelins dans tous les coins d'Algérie, arabes et français, fils et filles sans père qui devraient ensuite apprendre sans leçon et sans héritage.
(Extrait des pages 82 et 83)
Le juste
Au coin de la rue Prévost-Paradol, un groupe d'hommes vociférait. « Cette sale race », disait un petit ouvrier en tricot de corps dans la direction d'un arabe collé dans une porte cochère près du café. Et il se dirigea vers lui. – Je n'ai rien fait », dit l'arabe. « Vous êtes tous de mèche, bande d'enculés », et il se jeta vers lui. »Les autres le retinrent. Jacques dit à l'arabe : »Venez avec moi », et il entra avec lui dans le café qui maintenant était tenu par Jean, son ami d'enfance, le fils du coiffeur. Jean était là, le même, mais ridé, petit et mince, le visage chafouin et attentif. « Il n'a rien fait, dit Jacques. Fais-le entrer chez toi ». Jean regarda l'arabe en essuyant son zinc. « Viens », dit-il, et ils disparurent dans le fond.
En ressortant, l'ouvrier regardait Jacques de travers. « Il n'a rien fait », dit Jacques. –Il faut tous les tuer. – C'est ce qu'on dit dans la colère. Réfléchis.
(Extrait des pages 87-88)
La vie, la mort et la religion
A vrai dire, la religion ne tenait aucune place dans la famille. Personne n'allait à la messe, personne n'invoquait ou n'enseignait les commandements divins, et personne non plus ne faisait allusion aux récompenses et aux châtiments de l'au-delà. Quand on disait de quelqu'un, devant la grand-mère, qu'il était mort : « Bon, disait-elle, il ne pétera plus »S'il s'agissait de quelqu'un pour qui elle était censée au moins avoir de l'affection : »Le pauvre, disait-elle, il était encore jeune », même si le défunt se trouvait être depuis longtemps dans l'âge de la mort. Ce n'était pas inconscience chez elle. Car elle avait vu beaucoup mourir autour d'elle. Ses deux enfants, son mari, son gendre et tous ses neveux à la guerre. Mais justement, la mort lui était aussi familière que le travail ou la pauvreté, elle n'y pensait pas mais la vivait en quelque sorte, et puis la nécessité du présent était trop forte pour elle plus encore que pour les algériens en général, privés per leurs préoccupations et par leur destin collectif de cette piété funéraire qui fleurit au sommet des civilisations.
((Extrait des pages 181-182)
A découvrir aussi
- Le maître de Tala, roman de Saïda Azzoug-Talbi. Le parcours exemplaire d'un instit des petits indigènes
- La cité des roses, roman posthume de Mouloud Feraoun. Guerre et amour dans Alger.
- Escales, nouvelles de Mouloud Mammeri. Les rendez-vous ratés des algériens avec la liberté
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 29 autres membres